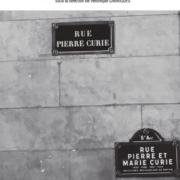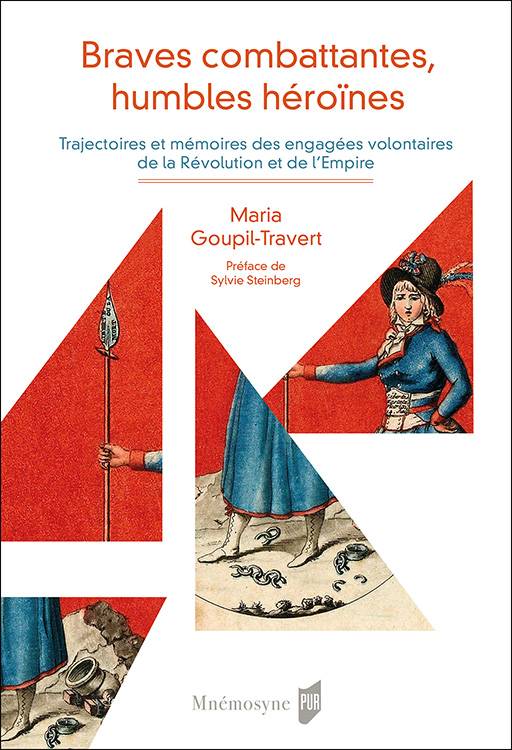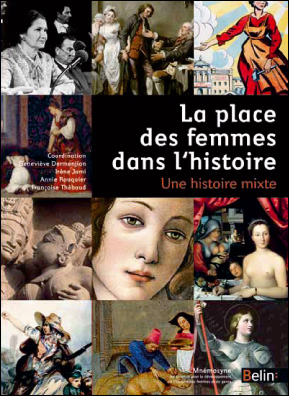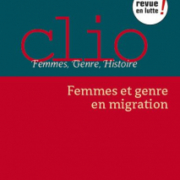Louise Francezon, L’espionne de la Seconde Guerre mondiale. Pratiques et représentations d’une « masculinisation » de la femme, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection Mnémosyne, 2024, EAN : 9782753595538
Avec une préface d’Elissa Mailänder
Dans une volonté de « mettre le feu à l’Europe », les services secrets ouvrent leurs rangs aux femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Loin du modèle de l’espionne courtisane et séductrice, ces femmes suivent un entraînement martial rigoureux et effectuent des missions de surveillance dans un cadre clandestin. En s’engageant au plus près des affrontements, ces agentes déstabilisent les frontières du genre, suscitant tour à tour inquiétudes et fantasmes.
Ces femmes qui s’affranchissent des attendus de la fémininité constituent une occasion privilégiée d’observer les reconfigurations de genre dans les mondes militaires. Cet ouvrage s’attache à relire l’histoire des espionnes au prisme du masculin pour comprendre les interactions, les résistances ou les réassignations de genre qui se jouent dans leur quotidien et leurs représentations. En confrontant « égo-documents », sources administratives et productions culturelles, cet ouvrage s’intéresse donc aux pratiques et aux discours qui fabriquent une figure, celle de la virago, pour écrire une nouvelle histoire des masculinités féminines.
Louise Francezon a soutenu son mémoire de master 2 à Sciences-Po Paris en 2021, sous la direction d’Elissa Mailänder. L’ouvrage a remporté le prix de l’Association Mnémosyne pour le développement de l’histoire des femmes et du genre, décerné à l’occasion de l’assemblée générale en janvier 2023.
L’ouvrage est disponible aux Presses Universitaires de Rennes

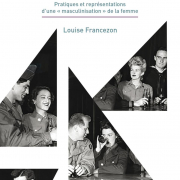 Presses Universitaires de Rennes / Association Mnémosyne
Presses Universitaires de Rennes / Association Mnémosyne
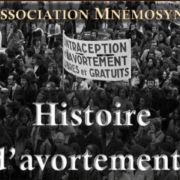
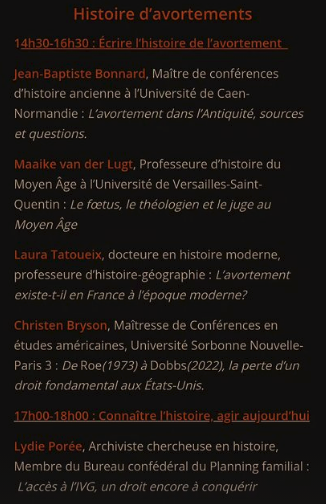
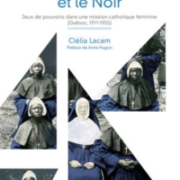
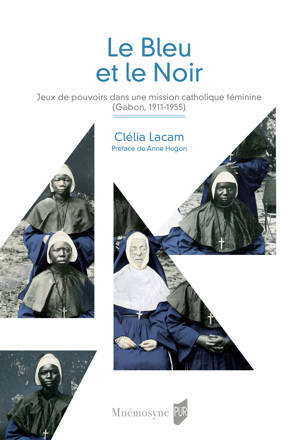
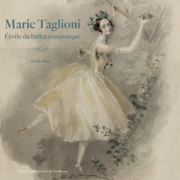
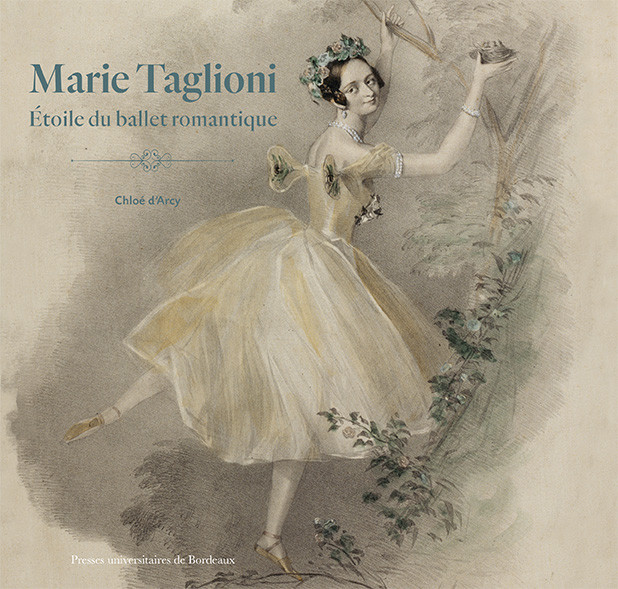
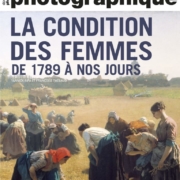 Documentation Photographique, CNRS Edition
Documentation Photographique, CNRS Edition