Compte-rendu de lecture par Dominique Gauthiez-Rieucau
Ière
Partie ; éclairages sur « L’intellectuelle »
Chap.
1. Bachelière.Marguerite Javouhey est née le 31 janvier 1886 à
Châlon-sur Saône (ville prospère de 30.000 ha) en Bourgogne,
seconde dans une fratrie de quatre enfants, au sein de la moyenne
bourgeoisie car sa famille se partage entre un immeuble du cœur
de ville et la proche « maison d’été » de Fontaines :
elle, sera « l’intellectuelle » de la famille ; sa
sœur Marie deviendra médecin, ce qui est aussi honorable et rare
pour l’époque (2% de « femmes médecins » en 1924).
Lors de ses études chez les dominicaines, où elle est « une
élève payante » vue la situation sociale de sa famille, elle
constate les effets des Lois anticléricales (elle a 18 ans en 1904)
et de la Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat : les
sœurs de sa Congrégation réussissent à contourner les décrets
d’expulsion et certaines continuent à enseigner, habillées en
civil.
Son
père, un commerçant aisé dans la quincaillerie, est un homme
autoritaire et elle trouve sa mère, femme au foyer, trop soumise.
Elle se construit donc sur deux autres figures tutélaires :
elle tient son côté militant à l’international de la
missionnaire Anne-Marie Javouhey (1779-1851), fondatrice de la
congrégation enseignante et hospitalière St Joseph de Cluny qui
compte au milieu du XIXème siècle une centaine de maisons à
travers le monde (Marguerite âgée de 64 ans assistera , à la
cérémonie de sa béatification, ordonnée par Pie XII :
en 1950) ; les missions en Afrique et en Guyane de sa parente ne
manquent pas de l’influencer et lui ouvrent la voie de tous les
possibles, bien que femme. D’autre part, comme son père est un
libéral conservateur, elle porte son estime sur un grand-oncle,
militant en 1830 lors de la révolution de Juillet et républicain en
1848, qui dispose d’une « bibliothèque fournie » et
Marguerite cache ses lectures socialistes à son père. Françoise
Thébaud date psychologiquement « l’événement fondateur
socialiste » chez Marguerite de la répression d’une grève
chez Schneider en 1900 : âgée de 14 ans, elle assiste à des
charges de cavalerie dans la foule des manifestants, ce qui
déterminera son engagement social.
En
terme de genre, Marguerite se révèle « à la fois moderne par
son (…) indépendance et traditionnelle en matière de conjugalité
et de sexualité »(p 42) : jeune veuve pendant la grande
guerre, à 29 ans, après trois années amoureuses de mariage avec
Georges ‒ il a fait les Beaux-Arts, est architecte mais succombe à
la tuberculose ‒, il semble qu’elle demeure fidèle à son
souvenir et renonce à toute vie privée amoureuse et sexuelle, pour
se consacrer aux études et aux responsabilités professionnelles.
Elle mène donc une vie de quasi célibataire, à l’instar de
Marie, mais Marguerite, elle, a donné naissance à Suzanne, sa fille
unique. Marguerite dira d’elle (qui divorce en 1960) qu’elle a eu
« un mariage malheureux » : cette génération de
femmes d’entre-deux-guerres paie souvent une activité
intellectuelle et professionnelle par l’impossibilité de fonder un
couple (moderne, égalitaire) car « les hommes bourgeois rêvent
d’une maîtresse de maison » (dixit la célibataire
volontaire Madeleine Pelletier, p 43) et craignent une femme qui
n’adhère pas à ce modèle stéréotypé, dans une vision de
complémentarité de la différence des sexes. J’ajoute que lorsque
Simone de Beauvoir écrit Le deuxième sexe, en 1949, une
autre étape est franchie : « la femme ayant accès à
l’instruction secondaire » se généralise après-guerre (le
nombre des bachelières n’équivaudra à celui des bacheliers qu’en
1972), mais « l’intellectuelle », qui veut créer une
œuvre comme elle et assumer librement sa sexualité, fait souvent le
deuil de l’enfantement (l’opinion dénigre encore les mères
célibataires, traitées de « filles-mères »).
« L’intellectuelle » fait encore longtemps figure
« d’exceptionnelle » et l’auteure Françoise Thébaud
se réfère, quant à elle (chap. 2, p58) aux Mémoires d’une
jeune fille rangée (publié en 1958) et cite S. de Beauvoir
agrégée de philosophie en 1929 : « les femmes qui
avaient alors une agrégation ou un doctorat de philosophie se
comptaient sur les doigts de la main : je souhaitais être une
de ces pionnières ». D’autre part, la femme qui travaille
mais est mariée n’a pas encore conquis son indépendance
économique (l’usage féminin du carnet de chèque ne sera autorisé
qu’en 1965).
L’auteure
insiste sur une autre donnée : seule la situation
économico-sociale spécifique des deux filles, Marguerite et Marie
la cadette, leur permet d’étudier et d’accéder à un emploi.
C’est à leur frère Pierre qu’échoit l’entreprise familiale
et elles deux sont indemnisées par des parts et autres titres de
rente, ce qui fait qu’elles vivent toutes trois (avec la petite
Suzanne) à Paris, aidées d’une domestique et peuvent fréquenter,
l’une la Sorbonne et l’autre la faculté de médecine.
L’intérêt de cette méthodologie de « biographie
impersonnelle » est effectivement de permettre au lecteur une
pensée critique, par cette balance permanente entre la biographie
individuelle et le collectif, le sociétal : l’itinéraire de
Marguerite est un fil rouge que l’auteure déroule tout le long du
XXème siècle, en historicisant faits et mentalités en mouvements,
révélant le genre en œuvre.
Chap.2.
Docteure ès Lettres et historienne.
Parmi
les points savamment développés par Françoise Thébaud, je me
plais ici à en retenir certains. Marguerite est licenciée de
philosophie en 1917, obtiendra ensuite un DES et débutera son
Doctorat en 1920, qu’elle obtiendra en 1926 : âgée de
quarante ans. Mère de famille, tout en poursuivant ses études
supérieures, elle travaille comme enseignante au Collège Sévigné
(rue de Condé, avant les locaux de la rue Pierre- Nicole) de 1917 à
1926, qui lui convient car c’est un établissement pour filles,
expérimental (dans ses méthodes et ses formations), novateur et
tolérant (ouvert aux israélites, protestants et aux athées dont
elle est…quoiqu’elle se plie, en 1924, à la coutume de la
« communion solennelle » de sa fille : en
« catholique sociologique » dirait-on de nos jours). L’on
y enseigne aux filles les sciences et depuis 1905, certaines y sont
préparées au Baccalauréat latin-langues.
Elle
choisit comme Directeur de thèse une personnalité proche de ses
valeurs, Célestin Bouglé (qui enseigne l’Histoire et la
sociologie) : républicain, dreyfusard, radical admirateur de
Saint-Simon, vulgarisateur « social moderne » au sens où
il est antimarxiste/antisoviétique et pluri-associatif, pacifiste en
particulier (président du Comité de la « Paix par
l’éducation », des « Amis de Proudhon » dont il
rééditera avec l’aide de Jules-Louis Puech l’œuvre complète
en dix-sept volumes, membre de la LDH…de la « Paix par le
droit » et militant de la SDN).
Féministe,
elle est, au lendemain de sa soutenance de
thèse « Le féminisme dans le
socialisme français
de 1830 à 1850 », la
cible (de même que Jane Misme,
fondatrice en 1906 de La Française) de l’antiféministe
notoire Théodore Joran (les féministes étant, selon lui, des
« orgueilleuses, vierges folles …ou mal mariées ») :
c’est l’occasion d’une joute dans la revue « La
Réforme sociale » entre le scientisme de Joran (n°
juill-août 1926, 18 p) et les apports scientifiques de Thibert (n°
nov. 1926, 7 pages). À la marge de la « République des
historiens » mais « historienne toute sa vie », MT
dédicace sa thèse à Marguerite Durand (La Fronde) « en
sympathie féministe ». Outre les articles qu’elle publie
dans les revues historiques (Annexe 3) elle s’avére aussi subtile
connaisseuse de Flora Tristan et de Pauline Roland (p 101). D’autre
part, elle est parrainée dans des « sociétés savantes »,
où les femmes se font rares, par Puech chez les « Amis de
Saint-Simon » et par Bouglé à la « Société d’histoire
de la révolution de 1848 ».
Bien
qu’adoubée par son jury (p 82), sa thèsereçoit une
réception mitigée dans la communauté des historiens…dans un
contexte où « l’histoire des femmes » est à
naître…alors le féminisme ! Le thème de sa recherche
demeure quasiment un « non-sujet » (FT p 98). Même la
thèse initiatique de Léon Abensour, enseignant en lycée, soutenue
en 1923 (La femme et le féminisme avant la Révolution) est
« éreintée » (p 98) par les (re)censeurs. Le lecteur
trouvera (p 99) les quelques recensions favorables à la thèse de
Marguerite Thibert. MT est membre du cénacle des Puech ; l’on
remarque que Bouglé est aussi proche du premier directeur du BIT
Albert Thomas. Bien qu’historienne et militante, n’ayant pas
l’agrégation, elle est d’emblée exclue de la « légitimité
intellectuelle des postes universitaires » et réussit à
trouver un emploi intellectuel adapté à sa valeur, grâce à ses
réseaux.
Chap.
3. Vacataire au Bureau international du
travail
Marguerite
y est recrutée en 1926, le BIT étant l’administration
de l’OIT, organisation
tripartite ‒ y œuvrent représentants des gouvernements des Etats
membres, des patronats et syndicats nationaux et internationaux ‒
dotée d’un C.A. et de la CIT (conférence
internationale du travail), sorte de parlement supranational
(p 178) : il élabore les projets de réglementation
internationale, riche de son service de documentation et apte à
procurer assistance technique et est subordonné au CA de l’OIT. Y
règne « l’esprit de Genève » pacifiste du réformisme
social (p 114-119). Son travail de vacataire au BIT consiste d’abord
à actualiser la synthèse de la
législation internationale sur les migrations (soit 3 volumes non
signés). MT y bataille pour la promotion des femmes fonctionnaires
et il faudra 5 ans pour que l’on stabilise sa propre situation sur
la pression de Fernand Maurette, haut fonctionnaire du BIT, époux
d’une ex-collègue de MT au collège Sévigné qui la fera affecter
en 1929, assuré de ses « compétences scientifiques » et
« de son sérieux » (p 139) à l’étude du travail
féminin ; la vacation étant une pratique courante au BIT mais
particulièrement longue pour elle, la titularisation n’interviendra
qu’en 1931 (par la création d’un poste dans la Division de
Recherches de F. Maurette).
Les
engagements militants antérieurs de Marguerite Thibert sont
adaptables à « l’esprit de Genève » : elle
est membre de la SFIO mais elle ne sera jamais communiste,
même après 1945 et malgré l’égalité/ la mixité des métiers
H-F en URSS ; membre également de
l’AFDU (son amie et conseillère, Marie-Louise Puech en étant
vice-présidente) liée à la FIFDU créée en 1919 par des
canadiennes, américaines et britanniques. Côté suffragisme, MT est
membre de l’UFSF, section française de
l’AISF (Alliance Intale pour le Suffrage des F) future AIF en 1926.
Elle appartient également à l’UFSdN
que M-L Puech crée en la détachant de l’UFSF. C’est son aînée
Cécile Brunschvicg (UFSF et La paix par
le droit) qui lui conseille en sororité de rencontrer à Genève la
suissesse Emilie Gourd, fondatrice-directrice du journal « Le
mouvement féministe ». M-L Puech lui facilite la
connaissance de Nina Spiller, amie de Cécile Brunschvicg (en 1926
celle-ci est puissante, directrice de La Française et
secrétaire générale de l’AIF). Nina est fonctionnaire à la SDN.
Travail en réseaux…
Il
semble que le tournant dans la vie privée de MT se situe en 1929,
quand elle sait qu’elle a un avenir au BIT : elle abandonne le
meublé genevois où elle vit avec Suzanne (scolarisée dans une
école internationale privée), vide son appartement de Paris et
s’installe vraiment à Genève, dans un nouvel appartement. Elle
fait partie du faible pourcentage de femmes qui ont obtenu un Permis
de conduire (3% en 1924 ; 10% en 1930) et s’offre une
automobile, instrument d’émancipation nécessaire au plan
professionnel, maternel, filial (Bourgogne) et amical (fréquente La
Borieblanque située dans le Tarn où les Puech reçoivent des
ami.e.s de France ou de l’étranger).
L’auteure
nous gratifie au passage (p 146) d’une perle d’antiféminisme :
la pièce de théâtre publiée en 1929 Les Précieuses de Genève
où les co-auteurs Francis de Croisset et Robert de Flers se moquent
« des femmes qui entendent jouer un rôle à la SDN et en faire
une tribune pour leur cause ».
C’est
dans la revue La Paix par le Droit (p 152) que MT publie ses
articles scientifiques et militants : sur « le
mouvement suffragiste depuis 1848 » (en 1927) et sur « les
dangers pour la paix des restrictions à l’émigration » (en
1929).
Le
travail des femmes est menacé par « la grande crise ».
Françoise Thébaud nous rend sensible, dans la militance du travail
féminin, la prudence de MT dans les tensions entre féministes :
entre « égalitaires » et « protectionnistes »,
elle cherche une médiane face à la pression de l’ODC (Open Door
Council, Londres) et de l’ODI (Open Door International, Berlin,
1929) riches de femmes aux métiers qualifiés (médecins, juristes,
prof. Libérales) …sur l’OIT, dont le directeur Albert Thomas
craint autant « les résistances doctrinales » des
organisations chrétiennes (opposées au travail des femmes mariées)
que celles des « porte-parole de
l’égalité » (p 161-163). Il semble que Marguerite mette sa
ferveur idéaliste dans une adaptabilité institutionnelle, cherchant
les compromis efficaces (positions plurielles des syndicats ouvriers,
complexité voire spécificité des métiers et des tâches, travail
de nuit, maternité…), favorable sur certains points à une
protection spécifique des femmes. Elle valorise son « expertise »
(p 165) et milite pour le poids grandissant de « conseillères
techniques » dans les conférences et aussi l’écoute des
principales intéressées (Ex pour l’emploi mixte de serveu.rs.ses
dans les bars des ports). Soit une idéaliste qui pratique
institutionnellement/professionnellement et vulgarise « le
féminisme d’expertise ».
MT
publie trois articles militants dans La Française : sur
la non prise en compte des femmes dans « le projet de
convention relatif aux salaires minima » (n° 21 juill. 1928) ;
sur le vote des femmes non indigènes aux Nelles-Hébrides / Océanie
depuis 1906 (n° 27 avr. 1929) ; et sur l’exemplarité de sa
parente défunte, la missionnaire Anne-Marie Javouhey.
L’auteure
nous donne à voir en Marguerite une femme forte, âpre dans la
relation mais nuancée dans l’analyse.
IIème
Partie ; éclairages sur « Une grande dame du BIT »
MT
s’est progressivement imposée : devenant en quelques années
la Cheffe d’un « Service du travail des femmes et des
enfants » créé en 1934 ; en rejoignant Montréal et en
contribuant après-guerre à la survie de l’OIT dans l’ONU, en
assumant ensuite son expertise dans les pays émergents.
Chap.IV
Cheffe du Service du travail
des femmes et des enfants et femme engagée au cœur des années 30
L’UISE,
Union internationale pour le secours des enfants a été créée en
1920, date qui est un repère signifiant dans la prise en compte des
Droits (et des souffrances) de l’enfance. MT, riche de ses missions
exploratoires de par le monde, dénoncera le travail des enfants et
s’attachera à la formation professionnelle des jeunes.
MT
donne suite à l’action de Martha Mundt (Div. des relations) et
construit peu à peu un centre de documentation sur le travail
féminin. Elle est bientôt appréciée pour ses relations avec les
organisations de femmes et liée aux milieux ouvriers et supervise la
traduction (anglais, espagnol, allemand) de La réglementation du
travail féminin (270 pages) qui remplace en 1931 la courte
Brochure de 1921. (…)
Elle
publie en 1933 dans la Revue internationale du travail un
article pour faire taire ceux qui incriminent les femmes
(« responsables de la surproduction et
du chômage ! ») et veulent
les renvoyer à la maison. L’article a un large écho auprès des
féministes et des militantes ouvrières. MT travaille en 1934
à la révision de la Convention sur le travail de nuit. Puis à un
« statut légal des travailleuses » qui paraîtra
en 1938 (cf. « Zoom p 254-261).
Dans
son Service, elle n’est secondée que par des femmes célibataires
diplômées (à l’exception de John Dickinson, homme marié). En
1935, lever de bouclier des Jeunesses chrétiennes contre le
travail des femmes (qui nuirait à la famille) : la CIT de
1935 inclut la question du chômage des jeunes et des jeunes
filles y sont invitées (dont la belge Emilienne Brunfaut qui
deviendra une amie). L’américaine Grace Abbott du Children’s
Bureau est une alliée et une recommandation progressiste sera in
fine adoptée pour la formation des jeunes.
L’on
retiendra le qualificatif savoureux qu’emploie l’auteure :
« une fémocrate (féministe bureau-technocrate) » au
cœur de réseaux féminins enchevêtrés » (p 244) qui
milite en sus …pour le désarmement au plan international, malgré
la menace grandissante fasciste et nazie.Elle dialogue avec des
femmes du monde entier, fonctionnaires du BIT et de la SDN ou des
déléguées associatives, ambassadrices nationales : la
suissesse Emilie Gourd, l’allemande Frieda Wunderlich (qui partira
à New York lorsque l’Allemagne se retirera de la SDN),
l’autrichienne Emma Freundlich (jusqu’à l’installation du
totalitaire Dollfuss en 34)…L’on sait que le BIT a vocation à
impliquer des européennes et des non-européennes : FT cite
l’espagnole Isabel de Palencia, l’Africaine du sud Hansi
Pollack, la mexicaine amie de MT Palma Guillen, la soviétique
Alexandra Kollontaï…(p 248). « Au-delà des conflits
personnels, par ex. entre Thibert et Cécile Brunschvicg ou
Malaterre-Sellier », FT souligne combien elles étaient liées
dans leur action militante (p 249). Parmi elles, femmage à Rosa
Manus, pacifiste hollandaise, militante pour le désarmement qui sera
gazée par les nazis.
Thibert
rend compte dans le Bulletin du CIF (Conseil
international des femmes) de la 25ème session de la CIT
(juin 39) : adoption d’une
résolution à visée égalitaire sur le travail féminin et
de recommandations sur l’apprentissage
et la formation professionnelle. Elle est représentante du BIT au
Congrès de l’AIF (Alliance internationale
des femmes) qui se tient à Copenhague l’été
1939 ; « les égalitaires
intégrales sont majoritaires dans ce congrès qui se tient en pays
nordique », réclamant une législation asexuée.
Chap.
V La seconde guerre mondiale, une épreuve, un tournant
Antifasciste,
MT est envoyée à La Havane en nov. 1939 puis
elle poursuit sa mission, élargie
au Mexique où elle visite Palma de Guillen …Suspendue en déc 1940
comme beaucoup de fonctionnaires internationaux
et réintégrée le 1er avril 1942, MT est active
et rejoint le Bureau qui s’est exporté
en partie à Montréal …sa Section étant rapatriée à l’automne
1946. L’on constate qu’elle pèse, à la Conférence
internationale du travail de 1944, comme
experte de la Commission de l’emploi au côté du
britannique Christie Tait, sur la Déclaration progressiste de
Philadelphie (Planche XII avec Eleanor Hinder et Bertha Lutz) visant
la promotion des droits humains (et qui débouchera sur nombre de
Conventions : liberté syndicale 1948 ; négociation
collective 1949 ; égalité de rémunération 1951 ;
abolition du travail forcé1957 ;discriminations emploi et
profession 1958 ; recommandation 123 sur « l’emploi des
femmes ayant des responsabilités familiales » 1965).
Chap.
VI. Missionnée aux quatre coins du monde
L’OIT,
qui a survécu à la guerre, réussit à persister, malgré des
rivalités avec les nouvelles instances (FAO, ECOSOC, UNESCO), en
tant qu’agence spécialisée de l’ONU. Au-delà de l’affrontement
est-ouest (l’URSS réintègre en 1954) et sous la direction au BIT
de Edward Phelan puis de l’américain David Morse (juin 1948-1970),
Marguerite maintient son esprit de coopération et veut servir la
reconstruction de l’Europe (plan Marshall) mais aussi le
développement tous azimuts, questionnant les conditions de vie des
travailleurs et la situation des femmes (formation). Il semble que
son premier vol en avion ‒ jusqu’alors elle voyage en paquebot ‒
ait eu l’Inde comme destination, en 1947.
Au
plan de sa carrière, MT doit batailler car, dans un premier temps,
« de prolongations ou renouvellements de contrats et congés
annuels à rattraper », bien qu’officiellement retraitée en
1947 (p 406), elle continue à travailler sur le terrain pour l’OIT
quasi sans interruptions jusqu’en avril 1951 (Salvador p 351) et
repart (Maryland, 1952) pour un séminaire de « formation
professionnelle » des Etats américains. Puis, après une
longue période de sédentarité, retraitée active, ses droits à
pension sont parfois suspendus et elle est rémunérée diversement,
sur des « contrats externes » à durée variable,
concernant d’autres missions qui courent de 1961 à 1966.
Elle
se rend ainsi dans des pays récemment décolonisés ou en voie de
l’être, apprend à se confronter à des conditions sanitaires
difficiles dans des pays « émergents » ou non du « tiers
monde », parfois même à l’insécurité (guerres
d’indépendance ou guerres civiles) et elle s’adapte à des
cultures, confessions et milieux sociaux multiples. Pour exemples,
elle contracte une hépatite infectieuse lors de sa première mission
en Asie (1947) et a un accident automobile à Alep (Syrie) en 1950
mais globalement, les délégués du BIT sont bien encadrés.
L’article élogieux qu’adresse Emilienne Brunfaut au Peuple en
juin 1956 évoque, sur un quasi « quart de siècle », les
passages de MT dans « une cinquantaine de pays ». Après
1947, elle continue en effet à partir en missions comme coopératrice
technique ; l’Annexe 5 (p665-666) répertorie 11 missions dans
plus d’une trentaine de pays, cela sur tous les continents :
Europe dont Grèce ; Asie dont Indochine, Chine et Inde ;
Mexique, Amérique latine dont Brésil, Chili, Argentine ; USA ;
Liban et Israël ; Egypte ; Moyen-Orient dont Irak, Syrie,
Iran ; et ses dernières missions la mènent en Tunisie (1965)
et en Algérie (1966).En Tunisie, son expertise porte sur la
formation professionnelle des femmes et des jeunes-filles (elle tente
de diversifier leurs préapprentissages).
Une photographie de MT illustre en pleine page un article signé par
Peggy Landers, intitulé « Femmes en mission » dans le
magazine Bit Panorama (n° 23, mars-avril 1967 ; cf.
Planche XIII).
L’on peut tenter d’éclairer certaines de ses positions ou
actions « progressistes ». En 1947,
elle côtoie P.P.Pillai, directeur du bureau de New Delhi, Elna Palme
Dutt, Ruth Gordon et Lore Bodmer (cf. Planche XIV). Lors de cette
première mission exploratoire en Asie (elle, est missionnée en
Inde, Indochine et Chine) visant à préparer une hypothétique
Conférence macrorégionale en Asie (qui n’aura pas lieu suite à
l’avènement de la Chine de Mao, 1949), MT porte un authentique
regard genré sur le travail (le
sexe et la hiérarchisation des métiers p
368), déplore le travail des enfants, les longues journées de
labeur et la faible productivité dans des
ateliers dangereux, la médiocrité du logement ouvrier (p
370), s’autorise des comparaisons sociales de pays à pays, malgré
des contextes totalement différents. Elle se heurte à une aporie
non résolue au XXIème siècle : la volonté de protéger la
maternité mais le risque de faire porter des structures de garde des
enfants aux employeurs « dissuadés d’employer de la
main-d’œuvre féminine » (p 368)…Quant à la guerre
d’Indochine, elle adopte une position médiane, celle de Marius
Moutet (ex-ministre des colonies) et de Léon Blum : elle est
favorable à une (utopique) association égalitaire dans le
cadre de « l’Union française ». Elle n’est ni pour
l’indépendance, ni pour la ligne colonialiste radicale car
elle-même reconnaît la « République démocratique du
Vietnam » autoproclamée en août 1945. Les rapports de mission
de MT, soit 25 pages pour l’Indochine et 19 pages pour la chine,
« sont (relativement) codifiés » (p368) répondant
techniquement aux demandes du BIT, d’où l’intérêt des autres
sources signifiantes. En termes
d’interculturalité, il est notoire que MT souligne « les
limites de l’enquête imposées par l’obstacle des langues ».
Son audace y pourvoit en partie : elle ne se contente pas de
visiter des plantations mais prend contact avec des syndicats
clandestins en Indochine et, en Chine, elle n’hésite pas à
rencontrer l’épouse de Sun Yat-Sen et interroge aussi des
communistes, agissant librement et pour servir la cause militante
au-delà de la stricte commande professionnelle du BIT. Le « rapport
confidentiel », lettre de neuf pages qu’elle adresse à
l’éphémère directeur du BIT Edward Phelan en mai 1947,
est un franc exposé où elle ne cache ni les rivalités entre
instances internationales (OMS, UNRRA, ECOSOC), ni les réalités de
terrain en Chine où elle sent la force montante des communistes,
qu’elle suggère de prendre en compte dans les enquêtes de
terrain. Après 1949, avènement de la République populaire de
Chine, et « au moins entre 1955 et 1966 », MT adhère à
l’Association des amitiés franco-chinoises
(p 372), militant pour que la France reconnaisse et normalise ses
relations avec la Chine et parce qu’elle est attentive « au
sort (à visée égalitaire) des femmes chinoises ».
Sa mission dans la Grèce instable d’après-guerre marquée par la
guerre, l’occupation, et devenue enjeu de la Guerre froide la porte
aussi à questionner « des mouvements féminins ». Elle
préconise (…) « une meilleure prise en charge de la
maternité, l’ouverture de crèches et de garderies d’enfants
pour libérer les fillettes du soin aux derniers nés et les envoyer
à l’école » (p 174).
Lors de sa seconde mission en Asie (Inde, Siam, Philippines,
Shanghaï), elle représente et impose
l’OIT à la 3ème session d’ECAFE (la commission économique de
l’ONU pour l’Asie et l’Extrême-Orient) en gagnant l’estime
de la britannique Beryl Power d’où une collaboration, session qui
se tient dans l’actuelle Udhagamandalam (p 377). MT adresse son
rapport Problèmes de formation professionnelle en Extrême-Orient
(200 pages) à l’OIT et à ECAFE et obtient la reconnaissance de
David Morse. Pour une mission comparable de 5 mois en Amérique
latine « chasse-gardée des Etats Unis » (p 378) en 1949,
elle parcourt dix pays et contribue, au nom de l’OIT, avec son
Rapport préliminaire lors de la 2ème session d’ECLA/CEPAL
(la commission économique de l’ONU pour l’Am. Latine) qui se
tient à La Havane en juin 1949 …au
futur « Programme de main d’œuvre ». Elle écrit à
Genève à Mildred Fairchild « qu’elle incite le Comité
féminin de l’Union panaméricaine à s’intéresser au droit
familial et non au travail des femmes, déjà traité par
l’OIT » (p 381)…ce qui nous révèle la militante doublée
de la tacticienne !
« Des missions exploratoires en matière de formation
professionnelle, la plus délicate (…) fut sans doute celle
effectuée au Proche-Orient » (p 382) : en 1950, dans le
contexte de la reprofessionnalisation des réfugiés palestiniens de
l’après première guerre israélo-arabe, MT se rend au Caire, à
Beyrouth, en Irak, Syrie, Iran et en Israël où elle rencontre Golda
Meir, alors ministre du Travail. Ses
rapports, non neutres, sont l’occasion de pointer des fragilités
spécifiques dans chaque pays, l’affectation sous-productive des
ressources humaines, et de dénoncer le travail des enfants (tapis
iraniens). En Israël, pays neuf qui accueille ses migrants, elle
constate l’efficacité de la confédération syndicale Histadrouth,
au plan de la formation et de la répartition professionnelle, en
égard à la productivité (p 384) ; envoie ses vœux, de retour
à Genève, pour le second anniversaire d’Israël, à Ben Gourion
et « un message de sympathie lors de la guerre des Six Jours »
(juin 1967) au ministre Zvi Bar-Niv, délégué à certaines CIT.
Elle entretient une correspondance avec son amie Germina Ron
licenciée du BIT et installée en Israël, dans laquelle perce son
admiration pour « la façon dont le pays s’est rapidement
développé en mettant toute sa population (hommes et femmes donc) au
travail » (p 385).
Ce qui importe à MT : mettre l’accent sur le travail des
femmes. L’on sait que son rapport au BIT de 1954 l’a amenée à
mesurer le rôle de« L’orientation professionnelle en
France ». En 1961, c’est elle que Elizabeth Johnstone
(Cheffe du bureau femmes et jeunes travailleurs), appelle à Genève
pour rédiger une étude sur « l’orientation et la formation
professionnelle des jeunes-filles et des femmes » qui sera
présentée à la CSW, Commission de la condition de la Femme de
l’ONU. Elle finalise et remet son rapport en mai 1962 « peu
avant que la CIT n’adopte la Résolution n° 117 sur la
formation professionnelle », tellement avancée qu’elle demeure au
XXIème siècle toujours aussi utopique (au vu des obstacles
culturels, des normes genrées en éducation, des charges familiales
des femmes) : elle doit être exempte de « toute forme de
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion,
l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine
sociale » (p 393). Même si la diffusion de son rapport, « avec
atténuation des conclusions » (p 393),
ne se fait en 1964 que sous forme ronéotée, MT trace le sillon
d’idées progressistes (l’harmonisation du travail féminin et de
la vie de famille…la valorisation des activités des femmes en
milieu rural…) qui feront leur chemin jusqu’à la Résolution
adoptée à la CIT de 1964 sur « la promotion économique et
sociale de la femme dans les pays en voie de développement ».
C’est lors de ses dernières missions, orientées « femmes et
développement » qu’elle appuie sur le terrain la formation
des jeunes-filles et des femmes comme un levier au service de leur
insertion professionnelle et de leur promotion sociale. Elle est
envoyée en Amérique latine en 1963, visite six pays en quatre mois
(Pérou, Brésil, de nouveau le Mexique…) et rend en 1964 son
rapport au BIT (qui sera publié sous une forme raccourcie) Jeunesse
et travail en Am. Latine : elle y fait état du travail
précoce des enfants pauvres, du sous-emploi des jeunes, de
l’inadéquation des diplômes et des offres d’emploi, du gâchis
éducatif, de la fermeture aux filles (vouées à la broderie,
couture, confection, tissage de tapis) de l’enseignement industriel
moderne qui leur ouvrirait des postes qualifiées. Pour les jeunes
indiens andins non scolarisés qui vivent dans la rue, MT propose
« un programme de récupération sociale et de formation
préprofessionnelle ». Ses suggestions porteront leurs fruits
des années plus tard, reprises en 1967 par E. Johnstone et L.A de
Vermès de l’Unicef qui concrétisera
des projets locaux en Am. Latine.
En Tunisie (1965), sa proposition
d’ouvrir des centres de préaprentissage diversifié aux filles, à
l’instar des garçons, sera suivie
d’effets, dans le contexte éclairé du bourguibisme. Elle suit
avec ténacité l’ouverture du centre pilote, aide l’experte
déléguée à contrer les obstacles, en particulier les réticences
pour n’ouvrir aux filles, outre la domesticité, que le secrétariat
et l’industrie du vêtement, dialogue avec l’UNFT dont elle
connaît bien la présidente Radhia Haddad ; en 1971, dix
centres OIT fonctionnent formant quelques 300 stagiaires filles et
l’UNFT en forment dans ses propres centres 1300. MT suggère de
moderniser les formations : bureautique, interprétariat,
technologies industrielles pour techniciennes et d’organiser des
stages mixtes. Extrait d’une lettre adressée à Bernard Caron,
expert de l’OIT, 20 fév. 1970 : « Le facteur le plus
puissant de libération des femmes dans les pays du tiers monde ‒
et surtout dans les pays musulmans ‒ c’est bien la possession
d’un métier leur permettant d’échapper à l’esclavage
familial et social : par exemple leur donnant la possibilité de
refuser un mariage arrangé (…) »
Dans l’Algérie de Boumédiène (au pouvoir à partir de 1965), où
elle enquête en binôme en 1966, elle propose de créer 70 centres
de préapprentissage pour les filles et plus du double pour les
garçons (projet qui restera lettre morte) et mesure les ravages de
la politique nataliste et de « l’orthodoxie coranique »,
de « l’esprit de domination des jeunes mâles » (p
399). Elle abonne, à ses propres frais, une militante syndicale
antinataliste à la revue du MFPF (le « planning familial »
depuis 1960 ex. Maternité heureuse née
en 1956). L’histoire dramatique (si l’on se réfère aux
« années noires ») n’a pas démenti son analyse
pessimiste.
MT n’est pas dupe du fossé existant entre les réalités sociales
et les discours internationaux : elle écrit en janv. 1967 à
une amie fonctionnaire du BIT (p 397) :
« on proclame solennellement à l’OIT que les
femmes doivent jouir de chances égales en formation professionnelle
et d’emploi, et sur le terrain, les experts du BIT se conforment à
tous les vieux préjugés. Je dois dire que je suis écœurée
par cette hypocrisie de l’Organisation, par ce clivage constant
entre les principes et la pratique ».
IIIème
Partie ; éclairages sur « Une citoyenne du monde et une
militante française »
Chap.
VII Parisienne aux larges horizons
L’auteure
ne nous cache pas l’attachement viscéral de MT à Paris qui
s’est installée à Genève et s’est engagée « à vie »
sur ce poste de titulaire à l’OIT en janv. 1931 mais exprime dans
une lettre de fév. 31 (p 183) qu’en fait son contrat « est
limité par l’âge (…) et laisse ouverte la perspective d’un
retour à Paris dans une vieillesse en somme pas très avancée ».
C’est
donc de la capitale ‒ elle s’installe définitivement à Paris
Villa Adrienne dans le 14ème arrondissement en 1956 ‒
qu’elle observe et agit, de manière pluri-associative, en
« citoyenne du monde » pendant plus de trois décennies
après-guerre. Sa fidélité dans ses engagements se traduit aussi
par un « devoir de mémoire » envers
le premier directeur du BIT et envers son grand complice de doctorat
: elle contribue à l’hommage rendu à Albert Thomas en 1957
en écrivant Albert Thomas vivant. Un
grand citoyen du monde. Etudes, témoignages, souvenirs,est membre des deux associations
« Société des amis …» et « Souvenir…» d’Albert
Thomas »,facilite
l’édition en 1959 de la 1ère thèse sur A. Thomas
soutenu par Schaper à Leyde en 1953 Albert Thomas, un siècle de
réformisme social et rédige pour la « Revue du Tarn »
en 1958 un In Memoria à Jean-Louis Puech. Et dans sa vie
privée ‒ accablée en outre par le suicide de son frère cadet
Pierre en 1951 ‒, elle s’applique à
soutenir nombre de ses amies militantes, certaines devenues veuves
(en sus de Madeleine Thomas et de Marie-Louise Puech, telle
Marie-Thérèse Maurette…), qu’elle reçoit pour des périodes de
repos, dans son chalet des Avants (canton de Vaud) acquis en 1948
‒d’où elle skiera jusqu’à l’âge de 80 ans ‒. Ce lieu est
familial (sa fille Suzanne a trois enfants), amical et militant :
l’on y vient du monde entier puisque Palma Guillen, Frieda Miller,
Emilienne Brunfaut le fréquentent…
L’on
sait que durant ces années, la construction de l’Europe constitue
un arrière-plan ; malgré la quasi « absence de
sources sur la position européiste de MT » (p 410), l’auteure
constate que celle-ci visait « le respect d’une hiérarchie
et la cohérence des normes adoptées par les différentes instances
supranationales » (p 411). Elle souhaitait que les normes
nationales et européennes s’adaptent aux normes mondiales.
L’acharnement que met MT à favoriser la 3ème réédition
en 1961 de l’«Histoire anecdotique du travail » de
Albert Thomas débouche sur des problèmes de diffusion auprès des
jeunes ‒ malgré l’interpellation de Françoise Giroud de
L’Express ‒ car les mentalités ont évolué, la
« nouvelle vague » impulsant ses idées et comportements
générationnels voire un ton différent (p 432).
Du
milieu des années 1950 au début des
années 1980, MT « navigue entre
missions internes pour l’OIT, militantisme dans des associations de
soutien, activités dans des ONG qui ont statut consultatif »
(p 417).
Elle
publie en 1957 un article pour la RIT,
« L‘afflux des jeunes sur le marché de l’emploi dans
les pays d’Europe occidentale et septentrionale ».
L’AIPS,
Asso. internationale pour le progrès social, proche de l’OIT,
renaît en 1953. C’est en tant que secrétaire générale de
l’AFPS, l’Asso. Française, que MT
prend part au Congrès de Milan de 1956 (y relançant les idées
basiques d’égalité H-F de la Conférence de Philadelphie 44) et à
celui de Bruxelles en 1958 dont un thème s’intitule …« Jeunes
d’aujourd’hui, hommes de demain », ce qui reflète les
réticences genrées de l’époque…MT favorise la création
d’une section de l’AIPS en Argentine…Elle réussit à faire
insérer dans la RIT, revue du BIT, une note progressiste liée au
Congrès AFPS de Bordeaux 1964 ‒ qui joue bien un rôle de
laboratoire et d’aiguillon (p 439) ‒ préconisant une formation
qui serve l’humain autant que les techniques productives,
anticipant des activités post-retraites pour les personnes âgées…La
dernière résolution adoptée à Bordeaux par l’AFPS concerne la
« préparation d’une déclaration relative à la condition de
la femme » décidée par l’ONU fin 1963 (rappel des
engagements de l’AIPS pour des droits égaux des travailleuses et
application effective des conventions 100 et 111 de l’OIT) qui
allait aboutir à un texte adopté en 1967 puis à la Convention de
1979 contre les discriminations (CEDAW). Elle demande une
« classification des emplois indépendante des sexes et des
chances égales en matière d’éducation et de formation » (p
439). À la pointe du débat se posent « les discriminations à
l’égard des femmes mariées » : lors du Congrès de
1970 qui se tient au BIT à Genève, son sous-directeur le suédois
Bertil Bolin prononce le discours inaugural dans ces termes inspirés,
évoquant « un père idéal, partenaire égal de la femme à la
fois dans la vie professionnelle, la gestion du foyer et l’éducation
des enfants » (p 440).
La
correspondance abondante que MT entretient de 1941 à 1975 avec la
mexicaine Palma Guillen (140 lettres en espagnol de cette dernière),
sa brillante amie haute fonctionnaire active dans les relations
internationales et l’éducation (p442-443) nous renseigne sur le
regard que chacune porte sur le monde. Palma avait épousé un
historien républicain espagnol en exil et le peintre Diego Rivera
lui offrit de ses toiles révolutionnaires ; les deux femmes
approuvaient la politique sociale de Lazaro Cardenas del Rio,
président de 1934 à 40 (réforme de l’éducation pour limiter
l’emprise catholique, nationalisations pétrolifères, distribution
de terres), et déplorent la dictature
installée en 1964 sous Gustavo Diaz Ordaz et la répression
sanglante de 68, dont celles des jeunes étudiants place « des
Trois Cultures ». MT y révèle sa fibre « tiers-mondiste » :
attentive à la politique sociale de Fidel Castro à Cuba, au régime
d’Allende au Chili (après le coup
d’état du général Pinochet en 1973, elle s’associe au groupe
d’accueil à Paris ‒ dont Edmonde Charles Roux et la communiste
Marie-Claude Vaillant-Couturier ‒des femmes exilées dont
l’écrivaine Isabel Allende elle-même).
En 1975, MT approuve, avec la mort de Franco, qu’une porte s’ouvre
vers la démocratie espagnole et avec la fin de la guerre du Vietnam,
que la réunification communiste apaise les souffrances. Par rapport
aux grands et au plan géopolitique, MT (membre des « amitiés
franco-chinoises »jusqu’à la révolution culturelle cf. p
455) craint « la puissance nucléaire chinoise », dénonce
en ces temps de guerre froide « l’hégémonie des USA »
et sera tardivement complaisante à l’égard de l’URSS :
jusqu’à la crise tchécoslovaque, la répression du printemps de
Prague de 1968 (p 446).
« Féministe
internationale », elle œuvre, y
compris par des dons financiers, au
« Bureau de liaison » issu de la rencontre
internationale de 1960, favorable à la détente, au rapprochement
entre femmes de l’Est, de l’Ouest mais aussi du Sud. La danoise
Anna Westergaard (figure de l’Open Door), à l’initiative d’une
grande rencontre féministe internationale, pour le cinquantenaire de
l’Internationale des femmes socialistes de 1910 réunie à
Copenhague (où l’on décida d’une « Journée
internationale des femmes ») et Emilienne Brunfaut ‒
secrétaire générale du RFP, Rassemblement des femmes pour la paix,
affiliée à la FDIF, « Fédération démocratique
internationale des femmes » installée à Berlin Est en 1951‒
amènent MT à œuvrer dans le Comité
d’initiative. L’année 1960 à Copenhague est donc l’occasion
d’un rassemblement de courants féministes de tous horizons sur le
thème « La condition de la femme, hier, aujourd’hui,
demain » et la personnalité « rassembleuse »
de MT permet de réduire des tensions multiples. La FDIF, née à
Paris en 1945 des réseaux de femmes antifascistes, est présidée
par Eugénie Cotton (française ex-directrice de l’ENS de Sèvres,
membre de l’AFDU) de 1945 à 1967 ; son mensuel est
justement intitulé Femmes du monde entier ; la FDIF
contribue parallèlement à l’organisation de la 1ère
Conférence de la femme afro-asiatique au Caire, en décembre 1960.
Elisabeth Johnstone du BIT, réservée vue les rapports de force
est-ouest, reconnaît la présence de « plus de 800 personnes
de plus de 80 pays » (p 457) et plus de 600 messages de
sympathie émanant de personnalités, d’associations variées
(telles des sections nationales de l’AIF, de la LIFPL Ligue
internationale des femmes pour la paix et la liberté, de la FIFDU
Fédération internationale des femmes diplômées des universités),
d’organisations syndicales ou professionnelles témoignent du
succès. MT rédige le rapport sur « la participation des
femmes à la vie économique » aboutissant dans son colloque à
l’adoption d’une résolution égalitaire H-F en matière de
formation professionnelle et salariale, sans oublier « les
travailleuses agricoles des pays sous-développés », ni la
nécessité de « réalisations sociales suffisantes pour
alléger les tâches des mères de famille », récurrence
obligée (p 458). D’autre part, le « colloque sur les droits
civils » émet 21 vœux égalitaires et un colloque
géopolitique discute sur « le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes », sur « le désarmement » et décide
l’envoi d’une délégation de 4 femmes à la 2ème
Conférence au sommet des Quatre Grands : déléguée en mai
1960, MT s’y entretient avec Khrouchtchev (p 459). C’est la
Déclaration finale de Copenhague qui revendique « une égale
responsabilité H-F dans les destinées du monde » et annonce
la création d’un « Bureau de liaison » international
« pour favoriser la coopération entre mouvements et
associations féminines », tâche ambitieuse.
Le
« Bureau de liaison » se réunit pour la première fois à
Rome en janvier 1961 ; le secrétariat est fixé au domicile de
E. Brunfaut et l’argent est rare, MT assume la Commission d’études
sur la conciliation féminine « des activités extérieures et
des responsabilités familiales », question toujours non
résolue et prioritaire en ce début de XXIème siècle. Malgré la
grave crise de Cuba (baie des cochons, avril 1961) et la menace
nucléaire qui s’ensuit, le Bureau va réussir à mettre en place
un « Forum mondial des femmes sur l’éducation des enfants et
de la jeunesse dans un esprit de compréhension entre les peuples »
à Bruxelles en novembre 1962 (à cette occasion, MT rassemble Nina
Spiller son ancienne collègue de la SDN, leader de l’AIF, des
membres de la LIFPL, de la FIFDU ; des femmes de plusieurs
générations s’y côtoient, comme Suzanne Lacore du gvt Blum
[1875-1975] et Marie-Thérèse Eyquem [1913-1978]). Françoise
Thébaud nous offre à lire un extrait savoureux d’une lettre que
MT adresse à Jean Piaget, insistant sur le rôle éducatif des
femmes en faveur de la paix, aporie signifiante (p 462). Parmi les
idées en cours : des manuels non chauvins d’éducation à une
citoyenneté ouverte, des festivals internationaux de films et de
littérature pour la jeunesse. Le Forum est médiatiquement couvert
par Marie-Claire, Heures claires et Femmes du monde
entier… Mais le Bureau disposant de peu de moyens, connaît un
regain d’activité en 1964, invité à Moscou, puis en marge de la
CIT, Conférence internationale du travail où Marguerite, seulement
auditrice cette fois, prend position en fournissant un
outil-memorandum à l’intention des acteurs concernés (sur la 6ème
question à l’ordre du jour de la CIT « le travail des femmes
dans un monde en évolution ») qu’elle intitule L’emploi
des femmes ayant des responsabilités familiales. F Thébaud
écrit (p 465) « La participation, le 18 janvier 1966 à Genève
du trio Palma-Marguerite-Emilienne à la réunion des représentantes
des organisations féminines internationales ayant un statut auprès
de l’ECOSOC n’a pas l’effet escompté ». MT est alors
inscrite, en France, au MDF (Mouvement démocratique féminin) dans
la mouvance socialiste mais est vraisemblablement perçue par
certaines militantes comme trop proche des communistes, deux ans
avant Prague…Le Bureau contribue encore au Séminaire international
féministe de Rome (organisé par 14 associations d’obédiences
variées) tenu en octobre 1966 ‒ Evelyne Sullerot, Gisèle Halimi
en étaient ‒ séminaire où MT est auteure du rapport général
introductif, évoquant la Convention sur les droits politiques des
femmes (droits de vote, d’éligibilité, d’accès à tous les
postes publics, ONU, 1952) qui impliquent aussi, selon elle, des
devoirs, donc un agir égalitaire de la part des femmes elles-mêmes
(p 467), cela avant de péricliter. Parmi les explications, Fr.
Thébaud note que la FDIF « qui a réintégré
le système onusien et sollicite Emilienne Brunfaut pour la
représenter à l’OIT, n’a plus besoin du Bureau de liaison »
(p 468). Les conclusions du séminaire de Rome sont adoptées à
l’unanimité, après la discussion de onze rapports ; elles
appellent les militantes à veiller au respect des textes nationaux
et internationaux égalitaires et au processus qui se profilerait à
l’ONU en vue d’une déclaration sur l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes (la CEDAW ne sera adoptée
qu’en 1979 !). Françoise Thébaud souligne aussi l’invite,
dans chaque pays, à créer un Comité pour la promotion de la femme,
à œuvrer pour une « démystification » dans l’opinion
publique, terme qui renvoie à la traduction en 1964 par Yvette
Roudy, présente au Séminaire, de l’ouvrage de Betty Friedan
(1921-2006) The Feminine Mystique. Soit un travail genré,
avant le terme heuristique, de déconstruction/reconstruction
des représentations.
L’on
sait que MT fait partie des membres fondateurs en 1961 de l’AAFV,
l’Association d’amitié franco-vietnamienne : l’AG
constitutive compte 8 femmes (Suzanne Colette-Kahn de la LDH,
Isabelle Pontheil qui dirige la section française de la LIFPL…)
sur 41 membres ; à l’issue de l’AG de 1966, le comité
français rassemble 55 personnes dont 16 femmes (l’historienne
Madeleine Rebérioux, engagée contre la guerre d’Algérie,
Marcelle Devaud sénatrice de droite…). MT est l’une des
signataires, avec Simone de Beauvoir, Charles Tillon de « l’appel
à la reconnaissance » de la RDVN, Rep. démocratique du Nord
Vietnam, après la chute du gvt Diem, fin 1963. L’AAFV soutient le
GRP, gvt provisoire révolutionnaire du sud instauré en juin 1969 et
est partie prenante d’actions pacifistes ou humanitaires communes :
Etats généraux pour la paix (1967) ; Assises pour le Vietnam
(qui aboutiront à la rédaction du Livre noir sur les crimes
américains au Vietnam (1969) ; meeting de Vincennes en mai
1970 ; Assemblée mondiale (1200 délégués de 84 pays) à
Versailles de Fév 1972 « pour la paix et l’indépendance des
peuples d’Indochine » (p 475). Le bulletin de l’AAFV et ses
publications fournissent des informations historiques et sur
l’actualité politique en Asie du sud-est, de qualité scientifique
et une aide est apportée sur le terrain par l’envoi de livres et
de médicaments. L’AAFV accompagne les tractations, conflictuelles
et complexes, depuis les Accords de Paris jusqu’à la proclamation
de la RSV, République socialiste du Vietnam en juillet 1976, selon
Françoise Thébaud, sans manifester un « esprit critique »
exigeant (p 477). L’autodétermination
des Vietnamiens du sud, la voie médiane
démocratique à laquelle l’AAFV aspire ne sont plus de mise dans
la réalité. À partir du 5ème Congrès de l’AAFV
(juin 1977), l’objectif sera le développement de la coopération
franco-vietnamienne ; MT rejoint la présidence collégiale (de
25 personnes) dont 4 femmes (Marcelle Devaud, Mariel Brunhes
Delamarre, Madeleine Riffaud, correspondante de guerre pour
L’Humanité et elle-même). Il semble que sa fidélité au
« peuple vietnamien » et à la RSV ne soit pas même
ébranlée, questionnée, par la question des boat people, croissants
au moment de la guerre sino-vietnamienne de 1979, constate Françoise
Thébaud (p 477). MT sera réélue lors du 6ème Congrès
de janv. 1982 (bien qu’âgée de 96 ans) par un nouveau Comité
national dont la composition, élitiste professionnellement et en
terme d’érudition, « traduit bien la mobilisation des élites
françaises anticolonialistes » (p 477).
« Pacifiste »
anti-nucléaire, Marguerite Thibert milite à la LIFPL, Ligue
internationale des femmes pour la paix et la liberté (dont le siège
est à Genève) « qu’elle apprécie de longue date (le mvt
est né lors de la première guerre mondiale) mais à laquelle elle
adhère seulement en 1955 (p 478). Yvonne Sée (1908-1997) ancienne
secrétaire générale de la section française rédigera en 1984 une
brochure sur la Ligue dont le titre « réaliser l’espérance »
d’un monde meilleur (p 478) éclaire la démarche ‒ pessimisme de
l’analyse et optimisme de l’action ? ‒. Toujours est-il
que la LIFPL est reconnue comme « ONG à caractère
consultatif » auprès de l’ECOSOC, Conseil économique et
social de l’ONU dès 1948 et de l’UNESCO dès 1949….Les
positions dans le contexte de la guerre froide sont complexes, ainsi
la LIFPL demande l’admission de la Chine populaire à l’ONU dès
1950 (ce qui ne sera effectif qu’en 1971) mais ne cautionne pas la
répression de l’insurrection citoyenne hongroise de 1956…
Lorsque MT adhère, la section française est présidée par Isabelle
Pontheil, communisante et opposée à Andrée Jouve qui représente
la LIFPL à l’Unesco ; mais plus que sur la question de la
guerre froide, il semble que l’adhésion de MT s’explique par la
position de la Ligue pour « la reconnaissance de l’État
d’Israël » et « le règlement pacifique des réfugiés
palestiniens » (p 480). MT devient amie avec Gertrude Baer,
juive allemande fondatrice de la section allemande en 1915 qui a fui
le nazisme en 1933, et l’aide à être réélue à l’exécutif
international au Congrès de Stockholm en 1959. MT est envoyée au
nom de la LIFPL à Stockholm, été 1967, comme membre du Comité
d’organisation du « Congrès mondial pour la paix au
Vietnam ». Appartenant à l’exécutif international, au
comité « Sections et contacts » de la Ligue, polyglotte
habituée à la sociabilité internationale, elle participe au
congrès triennal de la Ligue qui se tient au Danemark en 1968. Elle
est rapporteure, au titre de l’exécutif de la section française,
au Congrès de Londres sur les armes chimiques et bactériologiques
de nov. 1969 et aux « Assises sur le Vietnam » en
décembre 1969. Elle envoie à la section australienne de la Ligue en
juin 1971 un rapport sur l’usage des armes chimiques au Vietnam car
l’Australie lance une campagne contre la guerre chimique. En 1972,
elle demande à la secrétaire générale de la Ligue à Genève de
soutenir la parole de Mme Nguyen Ngoc
Dung (membre de la délégation du GRP à la Conférence de Paris) à
une Conférence sur le désarmement et l’environnement. Avec Yvonne
Sée, au titre de la section française, elle sollicite en 1977 la
section américaine…pour qu’elle lance une campagne d’aide des
USA à la reconstruction du Vietnam (réunifié en 1975).
C’est
Yvonne Sée qui se démène pour la Ligue, lors de la 1ère
« année internationale de la femme » de 1975 : MT
est occupée ailleurs, également représentante de la LIFPL auprès
de l’OIT (qui a octroyé à la Ligue un « statut consultatif
spécial »). MT choisit de participer au « Congrès
mondial de l’Année de la femme » organisé en RDA par la
FDIF en octobre 75. Car la FDIF qui a lancé l’idée d’une
« année internationale de la femme » à l’ONU, ne joue
pas un grand rôle au Forum des ONG de la Conférence internationale
de Mexico en juin 1975, pourtant reconnu par l’histoire, comme une
étape majeure vers Nairobi (1985) et vers la première plate-forme
commune de Pékin (1995).
MT
exalte l’universalisation et la pérennisation, chaque année,
d’une « Journée internationale de la femme » chaque 8
mars, au Congrès de Berlin de la LIFPL. (Yvette Roudy, Ministre
des droits de la femme, la concrétisera en France en 1982). La
secrétaire générale de la Ligue à Genève (de 1969 à 1992),
Edith Ballantyne (née dans les Sudètes en 1922 et exilée au
Canada) écrit à MT en 1976 que « la Journée des femmes
» est alors associée au communisme.
La
LIFPL décrète l’année 1976 « année du désarmement » :
Yvonne Sée s’exprime pour la section française à l’émission
« Tribune Libre » sur FR3 le 23 février et qualifie
Marguerite comme étant « l’une des plus éclairées »
de l’organisation. MT ne se rend pas au 21ème congrès
de la LIFPL qui se tient dans le Connecticut en 1980 mais prépare un
rapport sur les activités récentes de l’OIT pour les
participantes (suite au retrait des USA de l’OIT de 1977 à 1980
pour cause d’influence communiste).
Militante
contre les mutilations sexuelles qu’elle considère comme
« coutumes cruelles et dégradantes » déjà dénoncées
par la « St Joan’s Social and Political Alliance » au
temps de la SDN, MT soutient la position de la sénégalaise
féministe Awa Thiam, auteure de La parole aux négresses (Ed.
Denoël-Gonthier, 1978) et tente, vainement, de sensibiliser Edith
Ballantyne pour qu’elle engage la LIFPL, de responsabiliser la
FDIF, silencieuse sur ce sujet. Elle souhaite diffuser l’information
qui a circulé suite au séminaire de l’OMS organisé en février
1979 à Khartoum et voit la proclamation par l’ONU en 1979 de
« l’Année internationale de l’enfant » comme une
opportunité. Rien n’y fait. Mais MT approuve des journalistes
courageuses comme Claire Brisset qui s’exprime dans Le Monde
(p 486) et se rapproche en 1980 de Benoîte Groult, auteure de Ainsi
soit-elle (paru en 1975).
Tous
ces engagements pluri-associatifs internationaux n’empêchent pas
MT de demeurer fidèle aux congrès de la FIFDU, Fédération
internationale des femmes diplômées des universités…
Chap.
VIII changer la France des années 1956-1982
MT
s’engage pour l’alternance contre C. de Gaulle dès 1958. En 59,
s’éloignant de Marcelle Devaud (gaulliste), elle est à UFD
(Daniel Mayer). Elle se sent proche de Mendès-France, mais elle
soutiendra Mitterrand : le MDF (Mvt démocrate féminin dont
Marie-Thérèse Eyquem et Yvette Roudy) auquel elle se rallie (en
1962) adhérant à la CIR, Convention des institutions républicaines.
Les points de vue convergent entre le MDF (MT est membre du CA en
1965 et à anime la Commission travail) et la FGDS mitterrandienne
sur la promotion des femmes ; en témoigne le programme avancé
(contraception, crèches, congé de maternité à plein salaire,
égalité salariale H-F ! et représentation politique accrue)
pour les Présidentielles de 1965, lorsque Mitterrand met de Gaulle
en ballotage. Le MDF est clairement hostile aux
positions des femmes communistes (UFF) et catholiques (UFC).
Dans une pétition-motion du MDF (contre le PC-la CGT favorables à
une « retraite anticipée »), rédigée en 1965 par MT et
Colette Audry, intitulée « A propos du temps de vivre »,
le texte soulignait que « les tâches domestiques ne sont pas
un métier » mais « les problèmes des femmes » un
choix de société (p 504).
Quant
à la militance d’expertise de MT, qui vise à faire
(habilement) bouger les lignes, selon sa méthode habituelle
(réformiste de fait), l’on peut repérer et citer ici des textes
efficaces et qui restent d’une modernité affligeante au
XXIème siècle. Ainsi en est-il d’un Rapport sur « la femme
au travail » dans la Revue Esprit de 1961 suite à une
conférence donnée à Copenhague (posant la question des « choix
de métiers » car connotés H-F, des « temps de
travail » et des tâches domestiques) et de son Rapport sur le
« temps partiel » publié dans La femme du 20ème
siècle (n° 14) de 1969 qui est une mise en garde visionnaire
(le travail féminin ne devant pas être un simple appoint, et le
temps partiel surtout dévolu aux femmes). Elle œuvre aussi à la
sensibilisation des parents en faveur de la mixité des métiers,
contre les « filières féminines » dans l’éducation :
en témoigne son article de 1968 dans la Revue française de
pédagogie.
Notre
auteure F. Thébaud propose de se référer, pour ressentir ces
années 60, à l’émission télévisuelle de Eliane Victor « Les
femmes aussi » (1964-73) et à l’émission radiophonique de
Ménie Grégoire « Allo Ménie » sur RTL qui débute en
1967 (p 510).
« Femme
de dossiers » (et âgée de 81 ans !), militante
« institutionnelle » depuis l’intériorité des
documents professionnels et politiques, elle ne se présente pas en
personne aux Législatives de 1967 (où seront élues onze femmes au
total) et soutient les candidatures de E. Sullerot, Y. Roudy, C.
Audry, M-T Eyquem. Mais en tant que présidente de la Commission
Travail du MDF, elle contribue aux avancées des futurs projets de
loi : de nombreux éléments seront repris ultérieurement, dans
la Loi de 1972 et au-delà.
MT accompagne « mai 68 », alors âgée de 82 ans
(sa petite-fille étant étudiante à Assas) : sympathisante
lucide, selon le témoignage de E. Sullerot, elle intervient parfois
spontanément dans des amphithéâtres à majorité masculine et
investit souvent la cour de la faculté de droit du Panthéon, où
l’on tient forum. Je me plais à penser qu’elle mesure la
subversion culturelle historique en terme de genre, cela à
l’international (Mexico par ex. malgré la répression) même si
elle regrette, en France, cette opposition entre « révolutionnaires »
(elle ne participe pas aux grèves ouvrières) et « réactionnaires ».
Il semble qu’elle sous-estime le groupe FMA
(Féminin-Masculin-Avenir) fondé en 1967 au sein du MDF par
Jacqueline Feldman et Anne Zelenski, lequel sait mettre l’accent
sur la question centrale de la sexualité et des rôles sociaux m-f.
(le groupe évoluera en « Féminisme, marxisme, action »
et constituera avec d’autres groupes le MLF Cf. p. 517). Où l’on
retrouve la position réformiste de MT et constate une « affaire
de générations »…
Par
rapport au féminisme des années 70 (p 518), il est clair
qu’elle opère une hiérarchie entre « libération sexuelle »
(à laquelle se voue le MLAC) et « libération par
l’indépendance économique » qui prime à ses yeux.
Pourtant le mensuel de l’UFF, Heures claires, dans un
dossier sur «le féminisme d’hier et d’aujourd’hui »
ne classe pas MT du côté du passé (bien qu’elle soit une
féministe de la première vague, ait connu Alexandra Kollontaï
(1872-1952), Cécile Brunschvicg (1877-1946) et bien d’autres
belles personnalités qui ont fait l’Histoire…) mais du côté de
l’avenir. MT se pense « éclectique » et qu’il faut
« faire progresser la situation de la femme par tous les
bouts » (lettre p. 522). Au Bureau de
liaison, elle collabore avec des « femmes bourgeoises »
(car elle, est socialiste) et avec des « femmes
communistes ».
Figure
du Comité du travail féminin (p 522), organe consultatif, elle
œuvre donc aux questions du travail qui lui sont prioritaires, à sa
manière coutumière, au-delà des tensions et toujours en quête
d’une avancée potentielle : le CTF étant une « institution
militante au sein du ministère du Travail », elle l’investit
pour marcher vers l’égalité professionnelle (travaux d’Anne
Revillard, cités par F. Thébaud p 522).
Militante
féministe au Parti socialiste (p 535)
Une
photographie émouvante immortalise l’hommage que lui rend le
président Mitterrand, lorsque MT est invitée à assister le 2 juin
82 à l’ouverture de la 68ème session de la CIT,
Conférence internationale du travail. Âgée de 96 ans, elle
décédera quelques mois plus tard.
En
guise de Conclusion
À
l’occasion des 90 ans de l’Organisation (2009), a été publiée
une brochure pour rendre hommage/femmage aux femmes qui ont promu
l’égalité H-F « L’autonomisation des femmes : 90
ans d’action de l’OIT ». MT n’y est citée que deux
fois avant 1947, date officielle de sa « retraite »…fort
active jusqu’à la fin et qui lui fait vivre « le départ »
(p 414) de presque toutes les féministes dites « de la
première vague » ‒ jusqu’à la suffragiste Margery Corbett
Ashby en 1981, présidente de l’AIF, Alliance internationale des
femmes de 1923 à 1946 ‒. « Rien que pour la France (…)
Cécile Brunschvicg, Marguerite Angles, Gabrielle Duchêne,
Marie-Louise Puech, Germaine Malaterre-Sellier disparaissent
respectivement en 1946, 1954, 1954, 1966 et 1967 » (p 414).
Marguerite Thibert accompagne de fait plusieurs générations
(Marie-Thérèse Eyquem 1913-1978), même de l’après
deuxième-guerre. L’on doit à l’historienne Françoise Thébaud
d’avoir rectifié l’efficacité discrète de son parcours
militant exemplaire.
Le
centenaire de l’OIT, en cours de préparation, sera fêté en 2019…

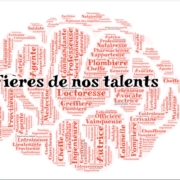
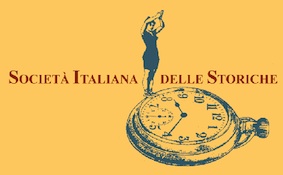
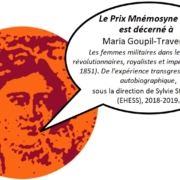
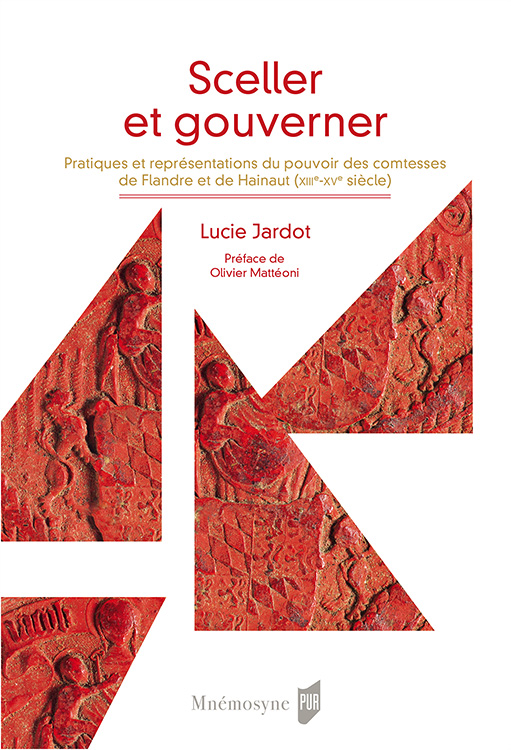

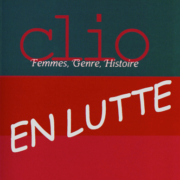
 L’association L’Escouade met en œuvre un beau projet d’usage civique de l’histoire à Ville de Genève – Officiel : « 100Elles* ».
L’association L’Escouade met en œuvre un beau projet d’usage civique de l’histoire à Ville de Genève – Officiel : « 100Elles* ».