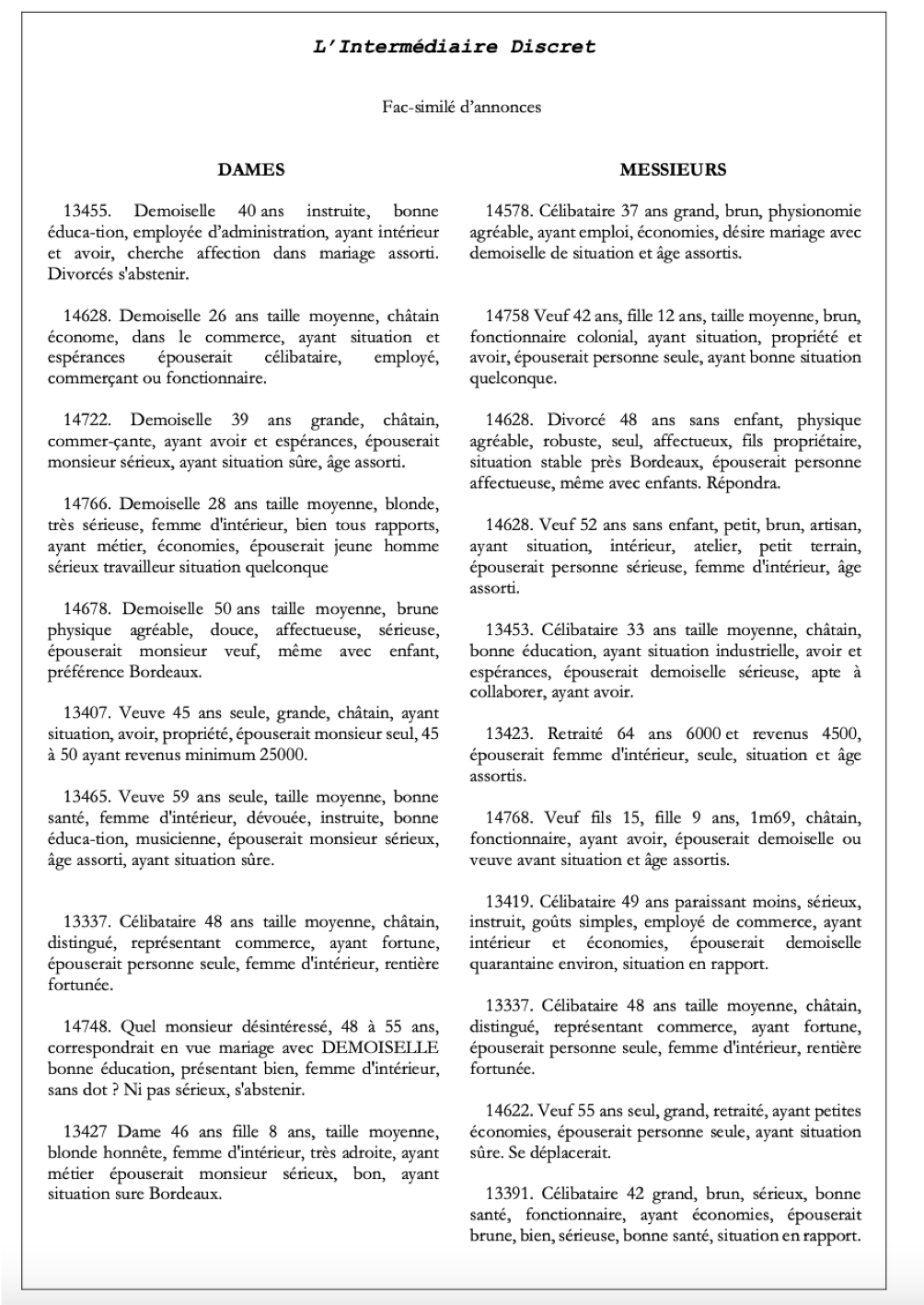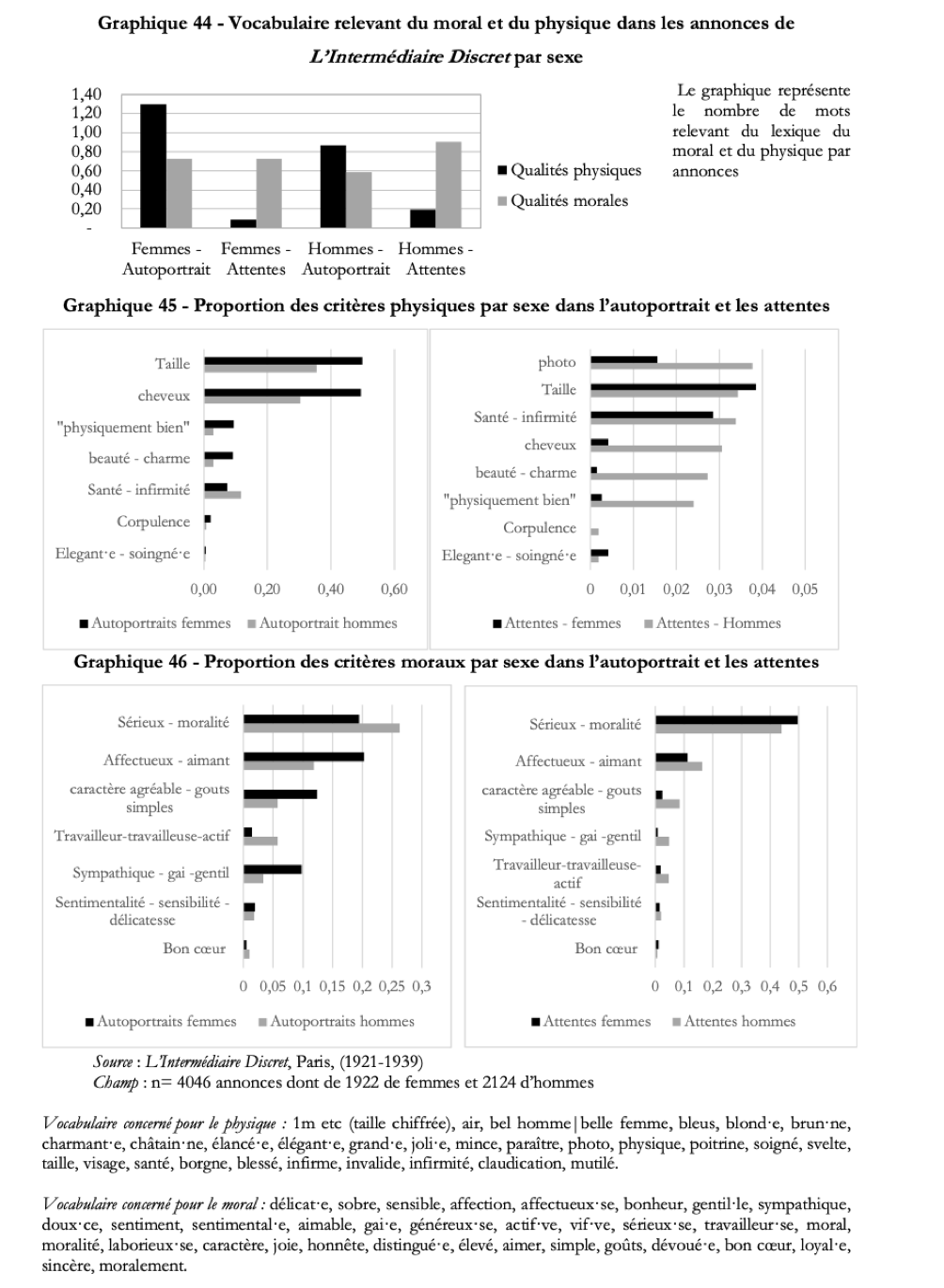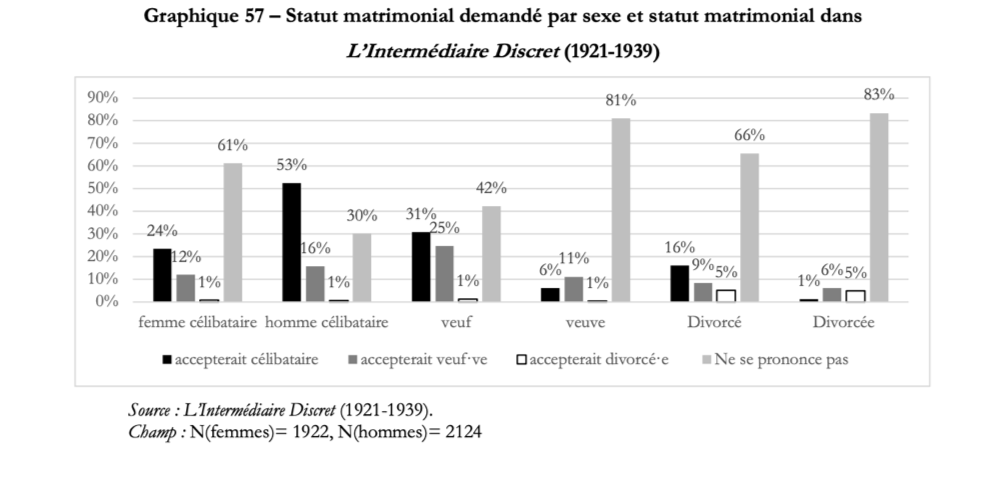Sport, genre et féminisme
Les JO de Paris approchent et c’est l’occasion de nous interroger, avec une perspective historique et une perpective de genre, sur la place occupée par les femmes dans le monde du sport depuis que les activités sportives telles que nous les connaissons se sont développées. En effet, la place que les femmes occupent dans le sport professionnel ou amateur est plutôt récente, et il a été difficile pour les pratiquantes de l’imposer dans un monde ou le corps des femmes était considéré comme un objet fragile, destiné à plaire avant de se consacrer la maternité.
Aujourd’hui, de grandes inégalités se maintiennent dans les choix de sports pratiqués par les femmes, dans les pratiques de chaque sexe, mais aussi dans le traitement médiatique réservé aux sportifs des deux sexes, sans parler du sexisme qui demeure très présent dans le monde du sport, que ce soit chez les pratiquants, les entraineurs, les dirigeants ou les commentateurs.
Pour nous retracer cette histoire du sport féminin sous l’angle du genre, et le relier à l’histoire du féminisme, nous accueillons Florys Castan-Vicente, chercheuse et maitre de conférence en sociohistoire à l’université de Saclay. En novembre 2020, elle a soutenue sa thèse intitulée « Un corps à soi ? Activités physiques et féminismes durant la « première vague » (France, fin du XIXe siècle-fin des années 1930) », dirigée par Pascal Ory.
Bibliographie :
- Bancel Nicolas, Blanchard Pascal, Boëtsch Gilles, Bolz Daphné, Gastaut Yvan, Lemaire Sandrine et Mourlane Stéphane (dir.), Histoire mondiale de l’Olympisme, Atlande, 2024
- Breuil Xavier, Histoire du football féminin en Europe, Paris, Nouveau monde éditions, 2011
- Castan-Vicente Florys, « Suzanne Lenglen et la définition du professionnalisme dans le tennis de l’entre-deux-guerres », Le Mouvement Social 2016/1 (n° 254), pages 87 à 101
- Castan-Vicente Florys, Bohuon Anaïs, « Emancipation through sport ? Feminism and medical control of the body in interwar France »
Sport in History, 2020, 40 (2), pp.235-256 - Castan-Vicente Florys, Bohuon Anaïs, Henaff-Pineau Pia, Chanavat Nicolas, « Les pionnières françaises du sport international des femmes : Alice Milliat et Marie-Thérèse Eyquem, entre tutelle médicale et non-mixité́ militante ? » Staps 2019/3 (n° 125), pages 31 à 47
- Castan-Vicente Florys, Bohuon Anaïs, Pallesi Lucie, « « Ni de seins, ni de règlement » L’athlète Violette Morris ou le procès de l’identité́ sexuée de l’entre- deux-guerres » , 20 & 21. Revue d’histoire, 2021/4 (N° 152), pages 87 à 105.
- Castan-Vicente Florys, Marie-Thérèse Eyquem. Du sport à la politique. Parcours d’une féministe, Préface d’Yvette Roudy, Paris, L’Ours, 2009.
- Castan-Vicente Florys, Un corps à soi. Activités physiques et féminismes durant la «première vague » (France, fin du XIXe siècle – fin des années 1930), thèse de doctorat sous la direction de Pascal Ory, Université de Paris I, 2020.
- Gallot Fanny, Anka Idrissi Naïma et Pasquier Gaël, J’enseigne l’égalité filles-garçons, Dunod, collection « La boîte à outil du professeur », réed.2023.
- Hidri Neys Oumaya, Juskowiak Hugo, Bohuon Anaïs, Bréhon Jean, « Ce que la presse écrite jeunesse donne à lire et à voir : le genre du sport », Éducation et Sociétés 2022/1 (n° 47), pages 63 à 80.
- Louveau Catherine, « Qu’est-ce qu’une vraie femme pour le monde du sport ? », dans Laufer Laurie, Rochefort Florence, Qu’est-ce que le genre ? Payot, 2014. Chap. 6
- Martin Camille, « Quand la puissance publique délègue l’égalité : ethnographie de la politique de développement du football féminin en France (2011 – 2017) », Thèse de doctorat, EHESS, 2017.
- Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, « Des femmes à la conquête des sommets : Genre et Alpinisme (1874-1919) », dans Clio Femmes, Genre, Histoire, 23(2006), « Le genre du sport « .
- Rennes Juliette (dir.), Encyclopédie critique du genre, Paris, La Découverte, 2016 (article Sport)
- Rey Javi, Galic Bertrand, Kris, Bonnet Marie-Jo, Violette Morris, à abattre par tous les moyens, 2 tomes, Futuropolis, 2018-2019.
- Terret Thierry et alii (dir.), Sport et Genre, Paris, L’Harmattan, 2005, 4 volumes.
- Volume 1: Terret Thierry (dir.), «La conquête d’une citadelle masculine », 388 pages;
- volume 2 : Liotard Philippe et Terret Thierry (dir.), «Excellence féminine et masculinité hégémonique », 304 pages;
- volume 3 : Saint-Martin Jean et Terret Thierry (dir.), «Apprentissage du genre et institutions éducatives », 396 pages;
- volume 4 : Roger Anne et Terret Thierry (dir.), «Objets, arts et médias», 274 pages.
Sitographie & ressources :
- AFP, « L’équipe norvégienne de beach handball sanctionnée pour avoir refusé de jouer en bikini », Le Monde, 21 juillet 2021, en ligne.
- Bernard Christine (prod.), « Femina Sport, premier âge d’or », épisode de la série « C’est du Sport ! », dans Une histoire particulière, France Culture, 16 août 2020.
- Carpentier Florence, Castan-Vicente Florys, Nicolas Claire, Dirigeantes du sport au XXe siècle, Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe [en ligne].
- Dossier Retronews, Suzanne Lenglen championne de tennis.
- Kessous Mustapha, « JO de Londres 2012 et Rio 2016 : Caster Semenya, la Sud-Africaine accusée de n’être pas assez femme », dans Le Monde Afrique, 31 juillet 2021, en ligne.
- Laurentin Emmanuel (prod.), « Footballerines, des femmes face à l’hégémonie masculine », épisode de la série « Histoire du football », dans La Fabrique de l’Histoire, France Culture, 23 avril 2019.
- Ripa Yannick , « Les femmes aux jeux Olympiques », Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe [en ligne].
Cinéma & documentaires :
- Juza Camille, Toutes musclées (4 parties), Arte 2022
- Panahi Jafar, Hors-Jeu, 2006
Textes et crédits :
- Texte 1 : « Mlle Suzanne LENGLEN », Le Figaro, mercredi 3 juin 1914
« Seize ans ! Peut-être moins ! Une silhouette ravissante d’harmonie physique ; les traits fins, allongés, de grands sourcils, une expression tranquille, grave, souriante et résolue ; une chevelure noire, serrée à l’antique par un ruban de satin, et se répandant en boucles.
Vêtue de laine blanche, comme drapée, agile, sûre de ses mouvements, où la force s’enveloppe d’une grâce infinie, Mlle Suzanne Lenglen est une merveilleuse évocation moderne de la beauté féminine de l’antiquité.
Elle joue dans la perfection, dans un style qui reste délicieusement, féminin.
Dans ses efforts, aucune de ces violences excessives et maladroites par lesquelles trop de femmes éprises d’athlétisme masculinisent si fâcheusement leurs gestes. »
- Texte 2 : « L’extraordinaire carrière d’une sportive : Violette Morris », dans Le Miroir des Sports, 3 juin 1925
« Violette Morris était déjà aussi puissante à l’âge de quinze ans qu’elle l’est aujourd’hui. Ses mensurations n’ont guère varié depuis 1910. Elles sont les suivantes : taille, 1m66 ; poids : 74 kg ; tour de cou, 0m40 ; tour d’épaules, 1m20 ; biceps, 0m29 au repos, 0m335 en tension ; poignet 0m16 ; mollet 0m40 ; capacité respiratoire, 4 litres. […]
Cette femme, d’une puissance et d’une résistance physique incomparable, d’une énergie que rien n’abat, qu’on voit toujours la cigarette aux lèvres et qui ne se trouve bien qu’en vêtements masculins, qui est professionnelle en sports mécaniques, en cyclisme derrière moto même, et qui reste amateur dans les autres jeux athlétique, cette femme ne songe pas à terminer de sitôt sa carrière. Audacieuse, infatigable, d’une absolue confiance en elle-même, d’une indifférence totale à ce que peuvent penser d’elle hommes et femmes, elle mène sa vie comme elle l’entend, tout entière dévouée au sport. »
- Texte 3 : «Le Procès de la culotte », in SAINT-AUBAN (dir.), Revue des Grand Procès contemporains, tome 36, 1930, p. 203.
Extrait du plaidoyer de Yvonne Netter, membre du conseil de la FSFSF et avocate de l’association, contre Violette Moris dans le cadre de son procès contre la FSFSF qui lui refuse en 1928 le renouvellement de sa licence, nécessaire à sa participation aux JO d’Amesterdam
« La femme française est restée toujours femme malgré son activité ; c’est son triomphe, et c’est aussi sa sauvegarde. La coquetterie si vantée des femmes n’est pas du tout un obstacle à leur développement, pas plus intellectuel que moral […], c’est une condition sine qua non de la réussite des femmes, c’est l’avis de nombreuses féministes ».
- Texte 4 : Extrait de la déclaration de Roland-Leinad, journaliste au Paris-Soir, journal proche de la droite républicaine. Article publié le 27 février 1930.
« Il ne peut y avoir de milieu. On est homme ou on est femme. Que je sache, il n’est pas raisonnable de vouloir être les deux en même temps. Puisque Violette Morris fait tout ce qu’elle peut pour n’être point une femme, qu’elle aille demander licence à une fédération masculine, si toutefois il s’en trouve pour accéder à son désir. Mais il n’est véritablement pas possible de tenir pour femme, une personne qui se fait couper les seins, s’habille en homme, fait métier de garagiste, cogne du poing sur la table, se baigne en caleçon, court dans les piscines, et dans les mêmes lieux, va délibérément se changer dans la partie réservée aux garçons. »
Générique : Warm Sunset par Romarecord1973, disponible sur Pixabay
Un podcast produit par l’Association Mnémosyne avec Cécile Béghin.
Noémie Gmür et Clémentine Letellier à la technique.
Clémentine Letellier à la lecture des textes.
Enregistré au sein du Studio La Poudre de la Cité Audacieuse.