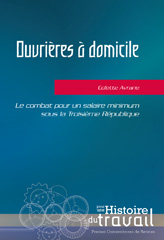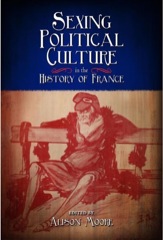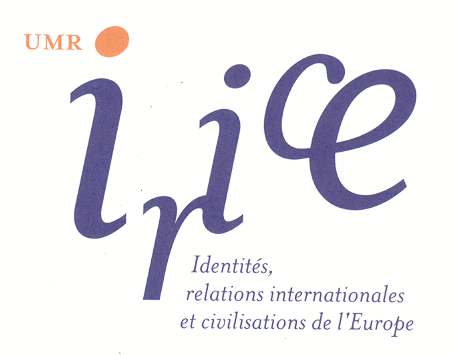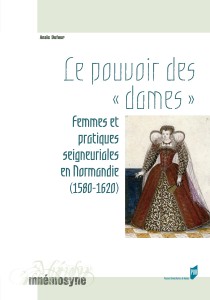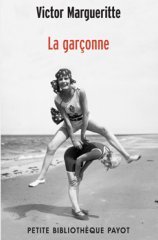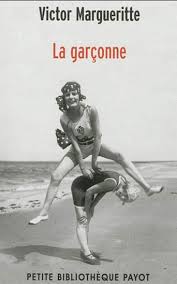L’Institut de hautes études internationales et du développement Genève, Suisse met au concours un poste à plein temps de professeur assistant en Histoire internationale avec spécialisation en genre pour entrée en fonction le 1er septembre 2014 ou à une date à convenir.
L’Institut recherche un professeur assistant en histoire internationale ayant spécialisation en histoire du genre et qui soit également sensible à d’autres approches critiques des études historiques, telles les approches féministes, la théorie critique de la race, la perspective intersectionnelle et celle des espaces interstitiels. Nous souhaitons que le candidat nommé renforce notre capacité dans un ou plusieurs des domaines d’études du département d’histoire internationale: i.e. l’histoire des relations internationales, transnationales, postcoloniales et globales durant la période de 1800 à nos jours. Nous encourageons les candidatures de spécialistes des pays du Sud et/ou des perspectives postcoloniales. Cette création de poste s’inscrit dans la stratégie de l’Institut d’intégrer le genre dans ses disciplines actuelles. Le candidat devra donc démontrer son expertise disciplinaire en histoire, tout comme sa connaissance des théories et des approches féministes, combinée de préférence à une connaissance d’autres théories critiques, anti-hégémoniques.
Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat en histoire internationale L’obtention du titre de docteur est une condition nécessaire pour l’entrée en fonction. La personne choisie assurera des enseignements au niveau postgrade du département de droit international et contribuera aux programmes d’études interdisciplinaires de l’Institut. Elle devra également diriger des mémoires de master et des thèses de doctorat. Une capacité de travailler avec des collègues issus d’autres disciplines est un atout.
L’enseignement sera donné en anglais ou en français. Une connaissance préalable du français n’est pas requise, mais il est attendu du candidat choisi qu’il acquière une connaissance au moins passive de cette langue.
Les dossiers de candidature, comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae et une liste de publications – mais sans lettres de référence ou échantillon de publications – doivent parvenir au directeur, de préférence par courriel (director@graduateinstitute.ch) ou par la poste (Institut de hautes études internationales et du développement, case postale 136 – 1211 Genève 21 – Suisse), avant le 30 septembre 2013.
Des informations sur les conditions d’emploi peuvent être obtenues à la même adresse.
L’Institut se réserve le droit de procéder par appel à tout moment.
Pour plus d’informations, les candidats sont invités à consulter le site internet de l’Institut:
http://graduateinstitute.ch/open_positions
Téléchargez le Profil de poste : Histoire internationale spécialisation genre
THE GRADUATE INSTITUTE | GENEVA
Institut de hautes études internationales et du développement
Graduate Institute of International and Development Studies
Rue de Lausanne 132 – PO Box 136 – 1211 Geneva 21-Switzerland