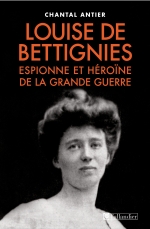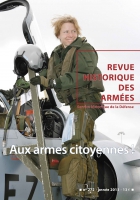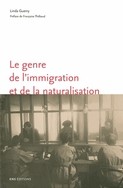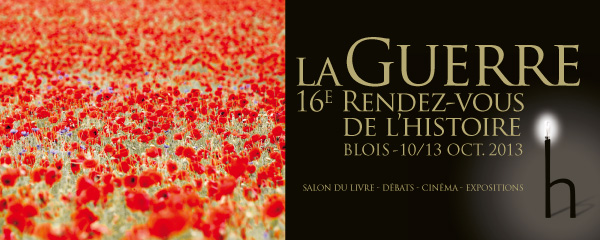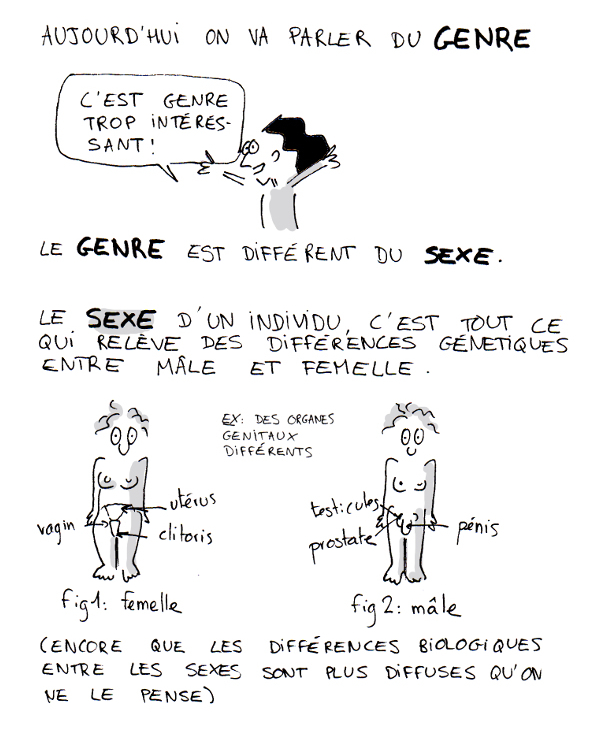Une Convention internationale qui s’impose aux États qui la ratifient
2013 : 30e anniversaire de la ratification, par la France,
de la Convention pour l’Élimination des Discrimination à l’Égard des Femmes (CÉDEF) 1.
Nicole Fouché, présidente de REFH, CNRS/Céna-Mascipo-EHESS,
Catherine Chadefaud, secrétaire générale de REFH, professeure d’Histoire en CPGE.
Site www.reussirlegalitefh.eu
Courriel : reussir.egalitefh@orange.fr
En 1945, la communauté internationale proclame, dans la Charte des Nations Unies : « […] Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Cette déclaration de principe — confirmée en 1948 par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la dite déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » — quoique fondamentale, ne suffisait pas pour aligner les droits des femmes sur ceux des hommes : il fallait mettre en place des mécanismes de contrôle pour la réalisation et l’application du principe retenu.
L’ONU, après débats, avait considéré que ces questions des droits des femmes devaient être examinées dans des instances dédiées, d’où la création, au sein de la Commission des droits de l’homme, de la sous-« Commission de la condition de la femme », érigée en commission de plein exercice en 1947 (en anglais, CSW : Commission on the Status of Women ; en français, CCF : Commission de la condition de la femme). La CCF comptait 15 États membres à sa création (aujourd’hui 45). La CCF est alors chargée de présenter au Conseil économique et social de l’ONU (Ecosoc) des recommandations et des rapports sur les voies et les moyens :
1) de promouvoir les droits des femmes,
2) d’améliorer leur situation.
La CCF est ainsi à l’origine de plusieurs conventions soumises à la ratification des États membres : 1952 (droits politiques des femmes) ; 1957 (nationalité des femmes mariées) ; 1962, (consentement au mariage, l’âge minimum des mariages et l’enregistrement du mariage). La Commission est à l’origine de la désignation de l’année 1975 comme l’« Année de la femme » et de la conférence de Mexico, première conférence thématique de l’ONU sur le sujet. Elle sera suivie des conférences de Copenhague (1980), Nairobi (1985) et Mexico (1995) qui furent l’occasion d’une mobilisation croissante des ONG de femmes. Le texte adopté par les Etats à l’issue de la conférence de Mexico invitait la CCF à rassembler dans un même traité à valeur normative les objectifs en matière d’égalité des sexes.
Pendant quatre ans, la CCF rédigea ce qui allait devenir la Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CÉDEF ; CEDAW de son acronyme anglais). Elle fut adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1979 et mise en œuvre en 1981 (après sa ratification par 20 États). La France a ratifié la CÉDEF en 1983. Cette Convention constitue une véritable synthèse des politiques encouragées par les féministes au cours des trois décennies précédentes. Elle envisage la promotion de l’égalité dans l’ensemble des droits : civils, politiques, sociaux, économique et de nationalité et prévoit des engagements concrets de la part des États membres pour en garantir l’exercice. Actuellement (2013) la CEDEF a été signée par plus de 90% des États représentés à l’ONU. Depuis 2000, un Protocole facultatif additionnel, ratifié par 70 États, dont la France, « judiciarise » la convention.
Les États qui ont ratifié la convention doivent remettre au secrétariat de l’ONU, dans l’année qui suit la ratification, un rapport dit rapport initial sur la situation de l’État au regard de ses engagements conventionnels et ensuite un rapport périodique, tous les quatre ans. Après consultation de ces rapports, le Comité d’experts de la CCF liste les principaux sujets de préoccupation et formule des recommandations aux États.
La CCF a inspiré, dans les années 1970, dans les instances intergouvernementales et nationales, la mise en place de services ou de ministères chargés des droits ou de la condition des femmes, d’abord au sein de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe, et désormais dans la plupart des États. On sait qu’en fonction des moyens qui leur sont accordés, l’influence de ces instances est plus ou moins importante… Aujourd’hui on parle d’inclure la notion de genre dans toutes les politiques. On le doit à la CCF qui continue à travailler sur de nouveaux droits.
Et en France ?
La dernière audition de la France devant le Comité, à Genève, date du 18 janvier 2008. Valérie Létard, alors secrétaire d’État à la Solidarité, a présenté le rapport gouvernemental, et Nicole Renault, le rapport alternatif de la Coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF), établi grâce à la contribution d’associations membres. Ce rapport a pour objectif de compenser les lacunes du rapport officiel.
Les principaux thèmes abordés dans le contre-rapport traitent, par exemple, du contexte législatif et institutionnel, de la participation insuffisante des femmes à la vie politique et publique, de la persistance des stéréotypes sexistes, notamment dans l’éducation et le choix des métiers, des violences à l’égard des femmes dans le couple, des discriminations dans l’emploi, des discriminations vis-à-vis des femmes immigrées et des femmes d’outre-mer. La Ligue des droits de l’Homme (LDH) a ainsi pu porter devant le Comité une note virulente sur la politique française sur la traite des femmes, politique qui criminalise les victimes au lieu de les protéger.
Les experts ont tenu compte de ces remarques.
Par ailleurs ils ont émis un certain nombre de recommandations. Le gouvernement français était incité :
- à faire campagne pour pousser les femmes à recourir à la HALDE,
- à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les médias,
- à prendre des mesures pour supprimer toute forme de traite et de prostitution des filles,
- etc.
- ces recommandations furent assorties d’une demande : faire connaître plus largement la Convention CÉDEF, par exemple en l’intégrant à la formation des personnels des professions juridiques.
Pour les « ouvrières » du rapport alternatif, cette occasion est précieuse. Elle ne permet pas seulement de faire remonter un ensemble d’informations : « C’est en travaillant sur le contre rapport en 2003 qu’a été découvert que les filles étaient mariables à 15 ans et les garçons à 18 ! », explique Bernice Dubois, de la Clef. C’est à cette observation que l’on doit, trois ans plus tard, l’alignement à 18 ans inscrit dans la loi française.
Les prochains rapports du gouvernement français (les 7e et 8e) doivent être soumis au Comité d’experts cette année. Le Ministère des Droits des femmes est en pleine rédaction ainsi que la CLEF (pour le rapport alternatif), au nom des associations du collectif.
Les Françaises ont toujours été très actives dans les instances onusiennes garantes de la CÉDEF : Marie-Hélène Lefaucheux, Jeanne Chaton et Marcelle Devaud. Plus récemment encore (2013), le mandat de Françoise Gaspard au Comité d’experts (2001-2008) a été suivi par la nomination de Nicole Ameline, ancienne ministre de la Parité et de l’Égalité professionnelle, comme représentante de la France au Comité d’ expert-e-s , puis par l’élection en 2013 de Nicole Ameline à la Présidence du Comité Cedef. Cette élection permet à la France de prendre un rôle de pilote pour la CEDEF.
Malgré leurs efforts réitérés, accompagnés par la levée récente (octobre 2013) des dernières réserves de la France à l‘application de la Convention pour l’élimination des discrimination à l’égard des Femmes 1 (CÉDEF), celle-ci peine à prendre, dans l’opinion publique française, sa place de texte fondateur. Quelques frémissements sont cependant observés.
Souhaitons que les années 2013 et 2014, qui commémorent le 30e anniversaire : d’une part, de la ratification de la France (1983), d’autre part, de l’application (1984), par la France, de la Convention et de son protocole additionnel, soient l’occasion d’une prise de conscience qu’un outil juridique international est à la disposition des femmes pour faire valoir leurs droits.
Ce texte a été compilé (15 novembre 2013) par deux membres du bureau de l’association « Réussir l’égalité femmes-hommes » (REFH) et relu par Françoise Gaspard.
Notes :
1) L’acronyme anglais est CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)
2) www. egalite-infos.fr/2010-12-21
3) Bibliographie :
- Bouet-Devrière Sabine (1999). « La question des réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes : les dangers d’une négation légitimée des droits de la femme », Les Cahiers Rémois, n°1, www.univ-reims.fr
- Gaspard Françoise (2006), « Les compétences parallèles : la condition de la femme » ; Collectif dirigé par Emmanuel Decaux, Les Nations Unies et les Droits de l’Homme, enjeux et défis d’une réforme, Éditions Pedone, Paris 2006, p 69-78.
- Gaspard Françoise (2007). « Les droits des femmes à l’ONU », Florence Rochefort, (Dir), Le pouvoir du genre, Laïcité et religions, 1905-2005, Toulouse, PUM.
- Gaspard Françoise (2013), « La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CÉDEF) », Historiens et Géographes, à paraître, décembre.
- Klejman Laurence (1989). « Les congrès féministes internationaux », in Mil Neuf Cent, Cahiers Georges Sorel, N°7.
- Procacci Giovanna et Rosellini Maria Grazia (1997). « La construction de l’égalité dans l’action des organisations internationales », Christine Fauré (dir), Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, PUF.
- Rupp Leila J. (1997). Worlds of Women, The Making of an International Women’s Movement, Princeton University Press, Princeton.
- Schöpp-Schilling Hanna Beate, Flinterman Cees, Editors (2007). The Circle of Empowerment, The Feminist Press at the City University of New York, New York.