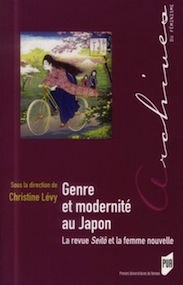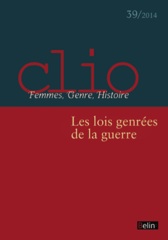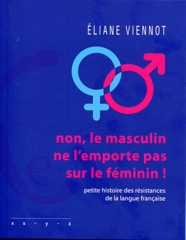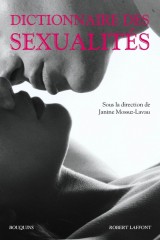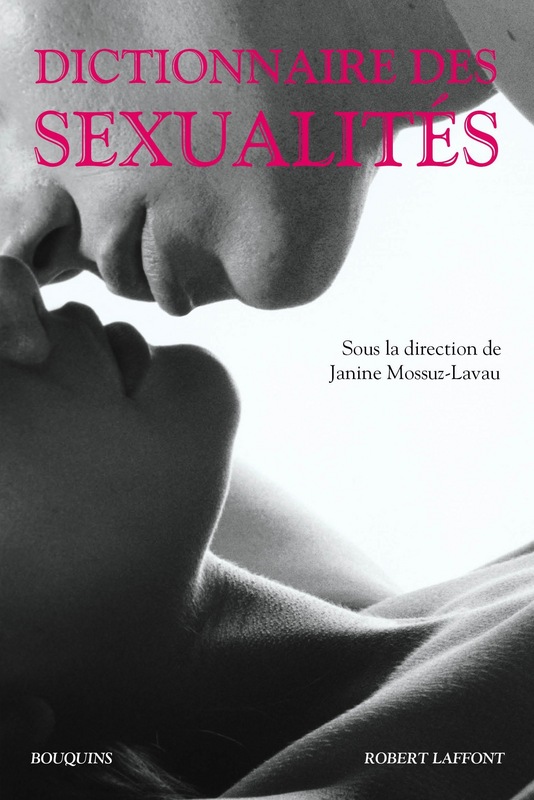La revue Seitô (traduction de l’anglais Bluestockings) parut de septembre 1911 à février 1916 : elle fut la première revue littéraire créée uniquement par les femmes, pour les femmes. Sous l’impulsion de Hiratsuka Raichô (1886-1971), puis d’Itô Noe (1893-1923), elle devint l’emblème des femmes nouvelles, rebelles à l’injonction de devenir de « bonnes épouses et mères avisées (ryôsai kenbo) ». Très vite, le mensuel et l’association furent désignés comme le nid des « Nora japonaises », et ses membres devinrent la cible des attaques contre les femmes nouvelles. Le magazine fut le centre d’aventures intellectuelles et artistiques, de débats où se nouèrent de nouvelles relations amicales entre les femmes, amours homosexuelles et histoires tumultueuses de femmes qui fuguèrent de leur province pour trouver refuge dans l’association. Parmi les milliers de pages de publication de cette revue littéraire, ce livre fait vivre ces temps de polémiques, qui nous saisissent tant par la fraîcheur de leur ton que par l’actualité de leurs propos. Le droit à l’amour libre, la contraception, l’avortement, la virginité, et la polémique autour de la prostitution font écho à nos propres interrogations.
L’enseignement ménager, rangé aujourd’hui au rayon des disciplines scolaires disparues, reflète les bouleversements culturels, idéologiques, économiques, démographiques, politiques et scolaires de 1880 à 1980. La redécouverte de ses contenus, de leur sélection et leur organisation, de sa doctrine pédagogique, de sa mise en ordre pour les enseignements primaire et secondaire, agricole et technique, permet de saisir les enjeux et les conditions d’existence des propositions contemporaines prônant la préparation à la vie dans la scolarité de base.
Genre et utopie rassemble les contributions de collègues et d’anciens étudiants désireux de rendre hommage au travail de Michèle Riot-Sarcey, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris 8. Ce livre est né du sentiment que notre actualité politique nécessite plus que jamais d’être questionnée grâce aux outils de l’histoire et de la pensée critique. Il postule que l’exhumation des utopies oubliées du XIXe siècle nous permet de mieux comprendre les impasses de notre présent.
De même, alors que les études de genre ont suscité récemment de grandes incompréhensions et mésinterprétations, il semble pertinent de rappeler que le genre n’est pas une « théorie » mais bien un concept permettant de dévoiler l’histoire des processus de domination entre les sexes qui sont toujours à l’œuvre dans notre société.
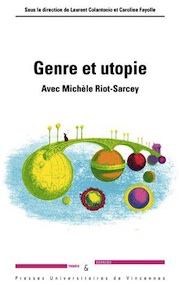 Dirigé par Laurent Colantonio et Caroline Fayolle, PUV, 2014.
Dirigé par Laurent Colantonio et Caroline Fayolle, PUV, 2014.
Les Lois genrées de la guerre
1914-2014, en cette année de centenaire, Clio Femmes Genre Histoire portera son regard sur d’autres conflits. Depuis la fin du XXe siècle, leur étude a été renouvelée, d’un côté par une approche anthropologique du fait guerrier et d’une attention nouvelle portée à l’intime, de l’autre par la focale mise sur les sorties de guerre. Par ailleurs, la guerre dans l’ex-Yougoslavie, puis le génocide des Tutsis au Rwanda, ont abouti à la constitution de tribunaux internationaux, le TPIY en 1993 puis le TPIR un an plus tard. La dénonciation de la violence sexuelle et la protection des populations civiles ont été de plus en plus prises en compte au niveau international et ces questions ont attiré l’attention des chercheurs. Ainsi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les violences faites aux femmes, et la mixité croissante de la sphère militaire ont constitué un marqueur fluctuant de ce que l’on dénomme « les lois de la guerre ».
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-clio-femmes-genre-histoire-n-39-23707.php
Responsable du numéro : Fabrice Virgili
Fabrice Virgili. Éditorial
Philippe Clancier. Hommes guerriers et femmes invisibles.
Le choix des scribes dans le Proche-Orient ancien
Sophie Cassagnes-Brouquet.
Au service de la guerre juste. Mathilde de Toscane WI1e-XIIe siècle)
Mariana Muravyeva. « Ni pillage ni viol sans ordre préalable ».
Codifier la guerre dans l’Europe moderne
Régis Schlagdenhauffen.
Désirs condamnés. Punir les « homosexuels » en Alsace annexée (1940-1945)
Alain Blum & Amandine Regamey.
Le héros et la martyre ou le viol effacé (Lituanie 1944-2000)
Christine Lévy. Le Tribunal international des femmes de Tokyo en 2000.
Une réponse féministe au révisionnisme ?
Regard complémentaire. Annette Wieviorka.
À propos des femmes dans les procès du nazisme
Actualités de la recherche. Françoise Thébaud. Penser les guerres
du xxe siècle à partir des femmes et du genre. Quarante ans d’historiographie
Isabelle Delpla. Les femmes et le droit (pénal) international
Documents. Alain Blum & Amandine Regamey.
Plainte et enquête autour d’un viol (Lituanie soviétique, 1959) 205
Témoignage. Une communauté de femmes en prison pendant la guerre d’Algérie.
Entretien avec Christiane Klapisch-Zuber par Michelle Zancarini-Fournel
Portrait. Rita Thalmann (1926-2013),
pionnière de l’histoire des femmes par Marie-Claire Hoock-Demarle
Varia. Agustina Cepeda.
Au temps du Test du crapaud. Justice et avortement (Argentine, mi-xxe siècle)
Rémy Pawin. Le genre du bonheur (France, 1945-années 1970)
Clio a lu – Clio a reçu
La domination du genre masculin sur le genre féminin initiée au XVIIe siècle ne s’est en effet imposée qu’à la fin du XIXeavec l’instruction obligatoire. Depuis, des générations d’écolières et d’écoliers répètent inlassablement que « le masculin l’emporte sur le féminin », se préparant ainsi à occuper des places différentes et hiérarchisées dans la société.
Ce livre retrace l’histoire d’une entreprise à la misogynie affirmée ou honteuse, selon les époques. Riche en exemples empruntés aux deux camps, il nous convie à un parcours plein de surprises où l’on en apprend de belles sur la « virilisation » des noms de métier, sur les usages qui prévalaient en matière d’accords, sur l’utilisation des pronoms ou sur les opérations « trans-genre » subies par certains mots.
Eliane Viennot, éditions iXe, 2014
http://www.editions-ixe.fr/content/non-le-masculin-ne-lemporte-pas-sur-le-féminin
Bien que numériquement important au tournant des XIXe-XXe siècles, le veuvage féminin n’est pas considéré comme un problème social, et ce, même si pour la femme, la perte de l’époux entraîne bien souvent de lourdes difficultés matérielles: seule une minorité est protégée par les règles du droit civil (contrat de mariage, héritage…). Largement ignorées par les pouvoirs publics, les veuves ne peuvent compter que sur elles-mêmes et sur la solidarité familiale ainsi que, pour les plus démunies d’entre elles, sur la charité ou sur l’assistance publique. Certes, on constate que depuis la fin du XIXe siècle se développe une protection dérivée de la veuve à travers la technique des pensions instaurées par les lois de 1831 et 1853. Ce système repose sur plusieurs critères: la durée du mariage, la présence ou non d’enfants à charge, l’existence ou l’absence de ressources suffisantes. Avec la Première guerre mondiale, le veuvage féminin est mis sur le devant de la scène et des mesures particulières d’assistance sont prises pour les veuves de guerre: emplois réservés, formation professionnelle, amélioration de la législation des pensions… Parallèlement, la protection dérivée de celles qu’on appelle par opposition les veuves civiles continue son expansion et se perfectionne, mais de façon dispersée dans un contexte économique difficile; la protection sociale de la veuve restant bien souvent instrumentalisée avec la poursuite d’autres objectifs que celui de lui assurer des moyens d’existence décents.
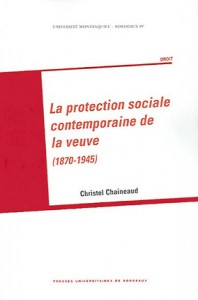 Christel Chaineaud, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014.
Christel Chaineaud, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014.
http://www.lgdj.fr/theses/233808834/protection-sociale-contemporaine-veuve-1870-1945
| Ce dictionnaire est le plus complet et le plus novateur à ce jour consacré aux diverses formes de sexualité et à la place qu’elles occupent dans notre société. | ||
| « Je ne sais pas quelle est la question, mais je connais la réponse : le sexe », disait Woody Allen. Ce Dictionnaire, unique en son genre, tente d’apporter plutôt des réponses que des interrogations. Sa première originalité est de traiter des sexualités et non pas de la sexualité. C’est-à-dire de prendre en compte les réalités d’aujourd’hui. Très longtemps, on a désigné la sexualité au féminin singulier et renvoyé d’abord au coït, lequel devait assurer la venue au monde d’une descendance. La norme était celle de l’hétérosexualité. Mais, dans la période récente, on a assisté à la multiplication des identités reconnues : il n’y a plus comme avant « la » femme et « l’ »homme mais aussi les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les queers, les intersexués. On est bien dans l’univers « des » sexualités. Celles-ci sont donc toutes présentes dans ce volume. L’autre originalité de cet ouvrage tient à la diversité de ses approches. Il montre comment ces diverses sexualités ont été perçues selon les civilisations, les religions (du catholicisme au bouddhisme), l’évolution des lois, les principales familles politiques, les grandes périodes de l’histoire et dans divers pays (des États-Unis à la Chine). Comment elles ont été abordées aussi à travers la littérature, la philosophie, la psychanalyse, la musique (de l’opéra à la chanson), le cinéma, la peinture, la danse (du flamenco au tango)… Sur les 400 notices que comprend ce Dictionnaire, beaucoup sont consacrées aux thèmes « incontournables » : amour, désir, érotisme, plaisir, amant, hédonisme, partenaires, rapports sexuels, séduction, sensualité etc. Mais on y trouve également des entrées plus originales, qui ont trait à des thèmes aussi divers que l’argent, la contrepèterie, la folie, les nanosciences, l’islam, les procès pour impuissance, la mode… L’ensemble va de A comme Abat-jour (éloge de la pénombre) à Z comme Zouk (la danse que chacun rêve de maîtriser). Ce livre se distingue enfin par la diversité et la qualité de ses auteur(e)s. Ils sont 185 : historiens, sociologues, démographes, juristes, écrivains, cinéastes, philosophes, psychanalystes, médecins, littéraires, politologues, anthropologues, critiques d’art, de cinéma, spécialistes du jazz et de la chanson, tous considérés comme le (ou la) meilleur spécialiste du sujet traité. Janine Mossuz-Lavau a fait appel non seulement à des experts, mais aussi à des témoins ayant fréquenté la personnalité sur laquelle ils écrivent, des acteurs et actrices (la tanguera parle ici du tango, le scénariste du film qu’il a écrit, la performeuse et la grande prêtresse du SM de leurs expériences). Ce Dictionnaire contient enfin des documents et des textes originaux, tels le Tract du Dr Carpentier ou des entretiens avec Françoise Héritier et avec Brigitte Lahaie. |
Janine MOSSUZ-LAVAU, Robert, Laffont, 2014
http://www.bouquins.tm.fr/site/dictionnaire_des_sexualites_&100&9782221130872.html
Les religions ont joué et jouent encore un rôle clé dans l’élaboration et la reproduction des normes de genre, à savoir le processus de différenciation et de hiérarchisation des sexes et des sexualités. Comment les univers religieux réagissent-ils alors aux mutations des mondes contemporains, en particulier sur les questions des droits des femmes, de la liberté sexuelle et de l’homosexualité ?
À travers une variété d’études de cas concernant la religion chinoise, le judaïsme, le protestantisme, le catholicisme et l’islam dans des aires géographiques contrastées, de la Chine, d’Israël, de la Tunisie, du Mexique, de la Polynésie à la France et l’Europe, cet ouvrage explore les adaptations, les reconfigurations ou les raidissements des normes religieuses, autant que les résistances notables qui s’expriment pour concilier croyances religieuses, égalité de genre et démocratie sexuelle.
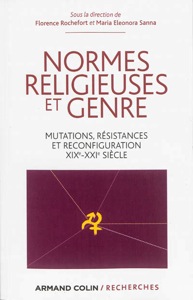 Florence Rochefort et Maria Eleonora Sanna, Armand Colin, 2013
Florence Rochefort et Maria Eleonora Sanna, Armand Colin, 2013
http://www.armand-colin.com/livre/479575/normes-religieuses-et-genre.php
Prix Mnémosyne 2012, le mémoire de Colette Pipon vient d’être publié aux Presses universitaires de Rennes
Colette Pipon, Et on tuera tous les affreux Le féminisme au risque de la misandrie (1970-1980), Rennes, PUR, février 2014
« Je ne suis pas féministe, parce que je n’en veux pas aux hommes. » Cette réflexion d’une ancienne militante du Planning familial établit un lien évident entre féminisme et haine des hommes. Peut-on faire l’hypothèse d’une misandrie travaillant le Mouvement de libération des femmes en France dans les années 1970 ? À partir de sources variées (presse, tracts, affiches, témoignages écrits et oraux de militantes), cet ouvrage en analyse la présence dans les discours féministes sur l’avortement, le viol, les relations de couple ou encore l’homosexualité.
Préface de Michelle Zancarini-Fournel.
Frère Luc, du monastère de Tibhérine, dont on sait l’enlèvement et la fin tragique en 1996, avait déjà connu la capture. C’était le 1er juillet 1959, en pleine guerre d’Algérie. Les hommes en armes qui l’avaient rapté ne le libérèrent que cinq semaines plus tard. En Algérie, contre toute attente, le FLN fit des prisonniers – militaires mais aussi civils, des hommes mais aussi des femmes – pour internationaliser le conflit grâce à l’action de la Croix-Rouge internationale. Beaucoup moururent. Leur histoire, qui est aussi celle de la première tentative d’appliquer les conventions de Genève lors d’un conflit, n’avait encore jamais été faite. Ce livre entend leur redonner vie, les réinscrire dans notre mémoire, et dire au plus près l’expérience de ces prisonniers de la guérilla, témoins étranges d’une guerre dont on a largement perdu le sens.
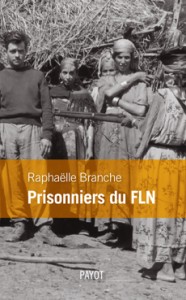 Raphaëlle Branche, Payot, 2014.
Raphaëlle Branche, Payot, 2014.
http://www.payot-rivages.net/livre_Prisonniers-du-FLN-Raphaelle-BRANCHE_ean13_9782228910293.html