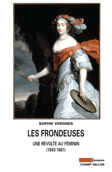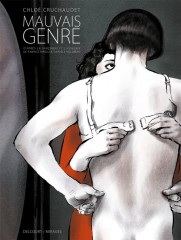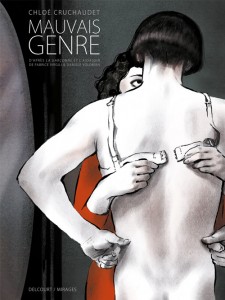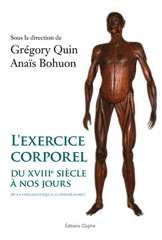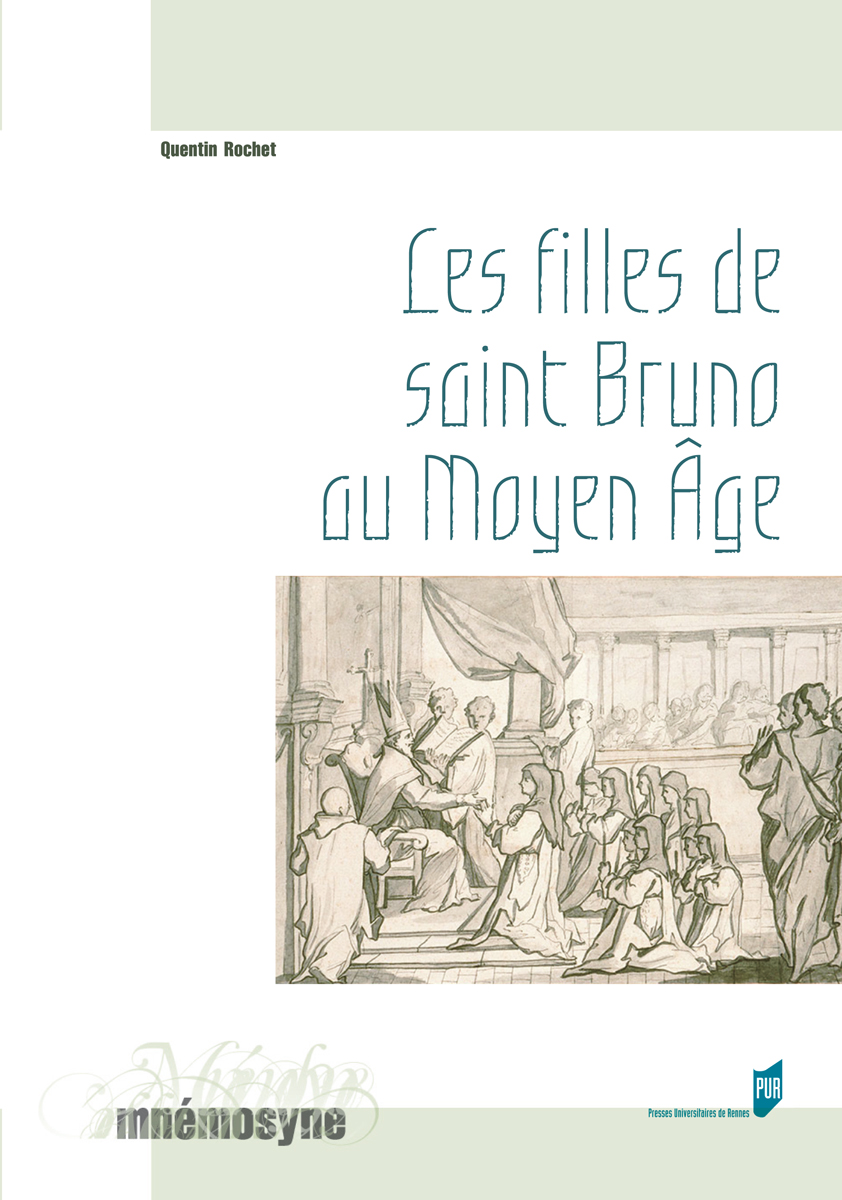Ce livre s’intéresse au rôle politique des femmes de l’aristocratie dans la Fronde et aux représentations dont il fait l’objet au XVIIe siècle, de façon à en faire apparaître les enjeux politiques, sociaux et culturels. Les actions accomplies, mais surtout les discours, les mises en scène et, plus généralement, toutes les stratégies de communication qu’emploient les Frondeuses et leur entourage pour intervenir dans la guerre civile sont examinés, ainsi que les témoignages des contemporains. Or, les sources écrites et la documentation iconographique révèlent une conception du pouvoir, du champ d’action des femmes et des rapports entre femmes et pouvoir bien plus ouverte et audacieuse que ne le laisse entendre la règle de l’exclusif masculin. Tous les projets politiques auxquels participent ces femmes, une quinzaine environ, sont considérés, du début de la régence d’Anne d’Autriche en 1643 à l’avènement du règne personnel de Louis XIV en 1661. Deux modes d’action principaux apparaissent : les interventions à caractère militaire des Amazones de la Fronde d’une part, celles qui relèvent de la diplomatie occulte accomplies par les « intrigantes » d’autre part. L’examen des moyens employés conduit à souligner l’ancrage des Frondeuses dans des réseaux familiaux, amicaux et clientélaires puissants où elles occupent des positions stratégiques. Pour plusieurs d’entre elles, l’analyse des actes et des discours avant, pendant et après les troubles civils pose la question d’une éventuelle démarche d’émancipation à caractère féministe
Les études sur le genre, qui ont connu un essor important depuis les années 1970, offrent de nouvelles clés pour appréhender les disciplines traditionnelles. Alors que la science politique se montre plus rétive que d’autres à la prise en compte des perspectives du genre, l’objet de cet ouvrage est de révéler leurs apports décisifs à l’analyse du politique.
Les notices de ce dictionnaire pionnier recensent les concepts, théories et objets canoniques de la science politique (citoyenneté, libéralisme, administration, partis politiques, mondialisation, etc.) en montrant le rôle central du genre dans leur genèse et leur maturation. Elles révèlent aussi le fonctionnement des inégalités entre les femmes et les hommes dans les partis, les assemblées, et la manière dont se fabrique et s’exprime le rapport entre les sexes dans les discours et les comportements politiques. Enfin, elles présentent les nouveaux concepts forgés par les spécialistes du genre (care, féminisme d’État, intersectionnalité, etc.).
Écrit dans une langue claire et accessible, fort d’une approche comparative entre études anglophones et francophones et d’une vaste bibliographie constituant un outil de référence indispensable, cet ouvrage tire aussi sa richesse de la contribution de plus de 50 spécialistes de différentes générations, qu’il s’agisse d’auteur.e.s qui ont créé des concepts ou mené les premières enquêtes sur le genre en politique, ou de jeunes chercheur.e.s qui les utilisent et les font vivre aujourd’hui.
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100050350
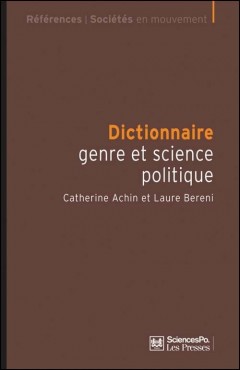 Catherine Achin et Laure Bereni (dir), Presses de Sciences Po, 2013.
Catherine Achin et Laure Bereni (dir), Presses de Sciences Po, 2013.
Paul et Louise s’aiment, Paul et Louise se marient, mais la Première Guerre mondiale éclate et les sépare. Paul, qui veut à tout prix échapper à l’enfer des tranchées, devient déserteur et retrouve Louise à Paris. Il est sain et sauf, mais condamné à rester caché. Pour mettre fin à sa clandestinité, Paul imagine alors une solution : changer d’identité, se travestir. Désormais il sera… Suzanne. [D’après l’essai La Garçonne et l’Assassin, éditions Payot]
À l’image des mouvements qui les ont produites, les affiches féministes sont hétéroclites, foisonnantes, utopiques. Et contrairement aux affiches communistes, socialistes ou fascistes, elles n’ont pas été fabriquées par des partis ou des organisations centralisées et structurées, mais par des groupes pluriels. Leur production laisse davantage place à l’artisanat. Leur objectif est de rendre visibles les femmes, les oppressions qu’elles subissent ou leurs combats. Il s’agit aussi de convaincre de la légitimité de la revendication de l’égalité entre les sexes, et d’influencer les mentalités en changeant les images disponibles, en revalorisant la femme et en proposant des rôles sexués alternatifs. Les affiches féministes sont ainsi en dialogue avec celles des partis politiques, mais également avec celles de la culture de masse, en particulier la publicité. Et comme il n’y a pas un féminisme, mais une multitude, cela conduit à une grande variété de styles et de messages. Pour autant, il est possible de repérer des continuités dans les thèmes abordés. Les auteures en ont retenu six : la vie politique ; le travail ; la maternité et la famille ; la colonisation et l’immigration ; la création artistique ; l’institutionnalisation du féminisme. Au-delà des évolutions chronologiques, ces questions traversent, comme autant de fils rouges, les luttes des femmes du XXe et du XXIe siècle.
http://www.myboox.fr/livre/femmes-en-lutte-2233365.html
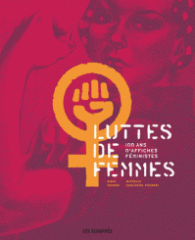 Bibia Pavard & Michelle Zancarini-Fournel,
Bibia Pavard & Michelle Zancarini-Fournel,
Éditions Les Échappés, 2013.
L’armée, l’école et le pouvoir politique sont connus pour avoir fait évoluer les usages de l’exercice corporel, cependant la part de la médecine et des sciences reste encore relativement inexplorée. En effet, si la participation des médecins dans la formulation d’une « éducation du physique » ne fait pas mystère, elle constitue un processus difficile à appréhender et les formes de l’engagement médical demeurent floues et méconnues.
Autour de quelques individus, de quelques institutions et de périodes charnières, cet ouvrage se propose de combler ce vide en analysant les dynamiques de la constitution de pratiques d’exercice corporel « médicales »
http://www.editions-glyphe.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1502
 Grégory Quin & Anaïs Bohuon, Paris, Éditions Glyphe, 2013.
Grégory Quin & Anaïs Bohuon, Paris, Éditions Glyphe, 2013.
Jusqu’au 30 septembre prochain, 7 panneaux illustrant par le texte et l’image les parcours de femmes résistantes de la Grande Guerre 14-18 dans la région Nord-Pas-de-Calais, sont visibles à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. Isabelle Vahé, historienne, est à l’origine de cette exposition rendant hommage à Louise de Bettignies , Angèle Lecat et la princesse Marie de Croÿ.
La princesse Marie de Croÿ a vécu une grande partie de sa vie au château de Bellignies, dans l’Avesnois. Elle a co-dirigé avec son frère un réseau de résistance qui évacuait les habitants du Nord, les soldats alliés ; les rapatriés des territoires envahis, en Angleterre via la Belgique et la Hollande. Elle fut arrêtée en septembre 1915 et jugée les 7 et 8 octobre à Bruxelles. Condamnée à 10 ans de travaux forcés, elle fut ensuite envoyée à la prison de Siegburg en Allemagne, près de Cologne, où séjourna quelques temps plus tard Louise de Bettignies. En prison, elle tomba gravement malade et refusa de fabriquer des munitions, comme le souligne un témoignage de sa résistance adressé à l’ambassadeur d’Espagne, visible sur l’un des panneaux de l’exposition.
Lectures musicales des lettres et des mémoires de la princesse de Croÿ
Lors des Journées européennes du Patrimoine, ce dimanche 16 septembre entre 14 heures et 18 heures, la Compagnie L’éléphant dans le Boa organisera toutes les 30 minutes, une « Création sur mesure, lettres de marie de Croÿ ». Cette animation consistera à des lectures musicales des lettres et des mémoires de la princesse de Croÿ.
L’exposition « Marie de Croÿ, une princesse résistante » est visible jusqu’au 30 septembre prochain à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, 89 Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux, de 10h à 12h et de 14h à 17h le lundi, de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi et de 10h à 12h30 le dimanche. L’entrée est libre et gratuite.
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, Isabelle Vahé sera présente le matin et l’après-midi, y compris le dimanche de 14h à 18 h, pour répondre aux questions notamment sur le projet de la maison Louise de Bettignies à Saint-Amand-les-Eaux.
La fiche de poste est également consultable sur le site de l’École et sur la BIEP
Niveau de recrutement : Catégorie A (niveau ingénieur d’études)
Localisation du poste : 190-198 avenue de France 75013 Paris
Le poste est à pourvoir par voie de mutation interne/externe ou par voie contractuelle (CDD) à compter du 1er octobre 2013.
Environnement et contexte de travail :
L’École des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « grand établissement » assurant une mission de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales et de formation à la recherche. L’établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants (avec près de 250 thèses soutenues par an dans toutes les disciplines des sciences sociales) et 1 200 masterants. Pour accomplir ses missions, l’EHESS dispose d’un budget consolidé de près de 60 millions d’euros dont 45 millions d’euros de masse salariale, de 300 personnels enseignants chercheurs et de 300 personnels IATOS. Elle est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales (300 chercheurs, 170 ITA membres des unités mixtes de recherche). Outre ses implantations parisiennes, l’Ecole compte trois implantations en région, Marseille, Toulouse et Lyon.
Les Éditions de l’EHESS (www.editions.ehess.fr) ont pour mission de faire connaître et diffuser, auprès de la communauté scientifique et du grand public éclairé, les recherches dans le domaine des sciences sociales. Elles accueillent les résultats de recherches inventives, qu’il s’agisse de premiers livres ou de recherches confirmées.
Parutions annuelles : Ouvrages : 25 nouveautés environ, réparties entre 9 collections ;
Revues : 7 à périodicités différentes.
Les Éditions se composent d’une direction scientifique (1 directeur, 1 coordinateur/trice), au sein de laquelle s’exerce l’emploi proposé, et d’un service des publications (comprenant 1 responsable de service, 7 secrétaires d’édition, 1 graphiste, 1 chargé de communication et diffusion, 1 chargé du développement international, 1 chargé de l’administration et finances, 1 régisseur de recettes, 1 chargé de la gestion informatique des stocks, 1 agent chargé de la logistique – magasinier).
Mission :
Assister le directeur dans l’ensemble des tâches de la direction (secrétariat, gestion de calendrier et d’agenda, organisation de réunions et de rendez-vousŠ)
Assurer la coordination des projets éditoriaux instruits ou initiés par les Éditions de l’EHESS et la planification éditoriale, en jouant un rôle d’interface entre le directeur scientifique, les auteurs et les évaluateurs scientifiques, le service des publications, les éditeurs partenaires.
Activités principales :
– Appui au directeur scientifique
– Rédaction de documents à l’attention des interlocuteurs des Éditions
– Gestion des flux de manuscrits et des procédures d’évaluation des projets d’ouvrages
– Conception et mise en ¦uvre des outils d’analyse et de gestion de l’activité éditoriale
– Relations avec les auteurs, les évaluateurs scientifiques, les comités des revues, les partenaires extérieurs
– Participation à la définition et à la mise en ¦uvre de la politique numérique (édition électronique, communication).
Compétences :
Connaissance des métiers de l’édition et de la chaîne éditoriale
Maîtrise des enjeux de l’édition scientifique
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacités rédactionnelles
Capacités d’initiative et autonomie, disponibilité
Goût du travail en équipe et varié
Sens de l’organisation et rigueur administrative
Maîtrise des outils de bureautique sous environnement Windows
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 20 septembre à :
Monsieur Emmanuel Desveaux, directeur scientifique emmanuel.desveaux@ehess.fr
Madame Hélène Moulin-Rodarie, directrice générale des services, dgs@ehess.fr
Mnémosyne est partenaire de Télédebout qui chaque année organise « Buzzons contre le sexisme », concours de vidéo « drôle, sérieuse, révoltée, déjantée ».
(voir le règlement : http://teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/)
Chaque année, nous offrons notre manuel La place des femmes dans l’histoire à plusieurs réalisations.
Cette année des équipes ou classes des six établissements suivants:
Collège Gustave Flaubert, 75011 Paris : 3e PRIX Catégorie 10-14 ans :Egaux (1’05)
Lycée Agricole de Mirande, 32300 Mirande : PRIX l’Etudiant Catégorie vidéo autonome : Robot Baby (10’05)
Ecole de la 2eme chance, 26000 Valence : 1er PRIX Catégorie 17-21 ans : Révolution (9’57)
Lycée agricole du Val de Seille, 57170 Château Salins : 1er PRIX Catégorie 15-16 ans : P+P ( 5’03)
Collège Jean Baptiste Corot, 87700 Aixe sur Vienne
Lycée Ozenne, 31 000 Toulouse
les vidéos primées sont en ligne http://teledebout.org/concours/palmares-videos-du-concours/
enfin vous trouverez sur le site de Télédebout la présentation de Mnémosyne par Pascale Barthelemy en vidéo bien entendu.
Le numéro 11 de la revue Genre et Histoire est en ligne
http://genrehistoire.revues.org/1634
avec au sommaire :
-
Francesca Medioli
-
Máire Cross
-
Louis-Pascal Jacquemond
-
Nessim Znaien
et comme d’habitude les rubriques « Comptes rendus » et « Travaux soutenus »
Bonne lecture et bon été
Quentin Rochet est la lauréat du prix Mnémosyne 2010.
L’ouvrage se propose de dresser un tableau de l’évolution de la branche féminine des Chartreux, de son apparition jusqu’au XVe siècle. Il s’agit ensuite, sur la base de cette synthèse chronologique, de chercher à comprendre si les moniales cartusiennes, bien que peu nombreuses, constituent une branche pleinement intégrée à l’ordre des Chartreux ou s’il s’agit d’un phénomène secondaire, marginal par rapport à la branche masculine.
Une question qui s’applique aussi bien à leur mode de vie, qu’à la liturgie qu’elles mettent en oeuvre ou à la spiritualité qu’elles ont pu développer. Originalité du monachisme féminin médiéval, adaptation d’une règle érémitique à un publique féminin pourtant peu apte à ce mode de vie dans la vision médiévale, épiphénomène ou branche à part entière de l’ordre chartreux, les questions posées par l’expérience des moniales cartusiennes sont nombreuses.
C’est aussi la différenciation des sexes dans la société médiévale, à partir d’un idéal monastique commun, qui se dessine. C’est également l’occasion de montrer que l’on peut, par l’histoire du genre, faire avancer l’histoire religieuse, celle des moniales d’abord, mais également celles des Chartreux eux-mêmes puisque l’attitude qu’ils adoptent tout au long du Moyen Âge -et l’évolution de leurs postures- permet d’appréhender leur vision des femmes médiévales en général et celle des moniales en particulier.