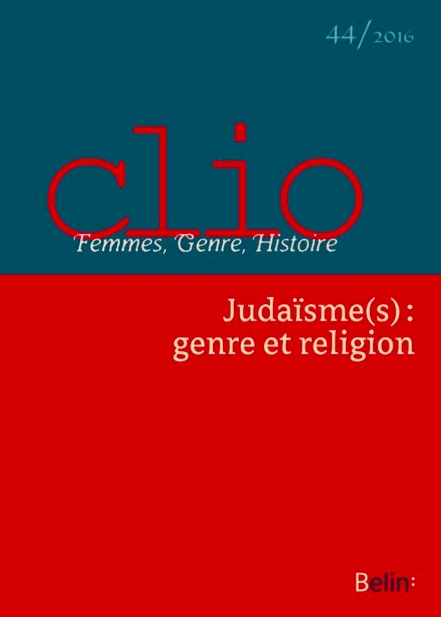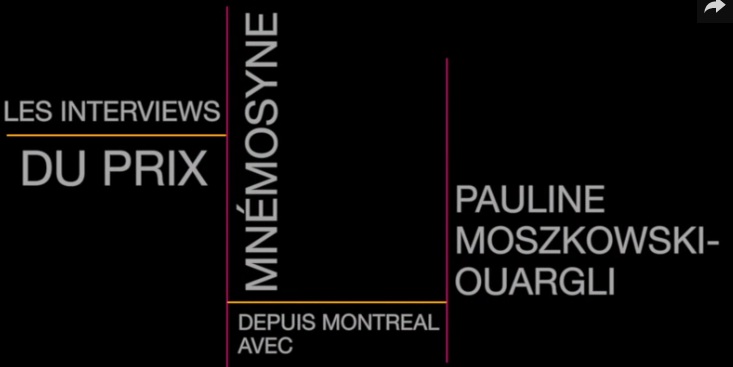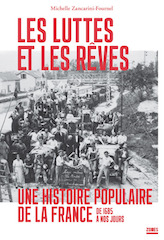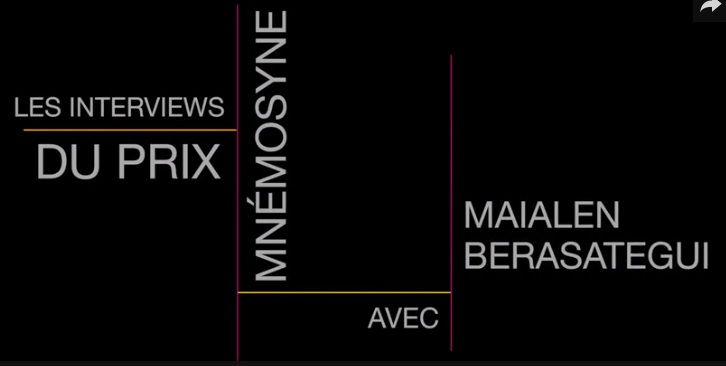Nature du genre, genre de la nature : les combats environnementaux en Europe, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours
L’histoire environnementale et l’histoire du genre ont toutes deux profondément renouvelé les études historiques, mais elles ont longtemps suivi des chemins différents, qui ne se sont croisés qu’à la fin des années 1980, en particulier avec les travaux de l’historienne américaine Carolyn Merchant[1]. Le bilan établi plus de vingt après par Nancy Unger reste mitigé[2] : les recherches au carrefour de ces deux approches se sont certes multipliées, mais le genre demeure encore relativement peu utilisé dans l’historiographie de l’environnement, ou alors d’une manière essentialiste dont Melissa Leach et Cathy Green ont montré les limites dans un article fondateur[3]. Par ailleurs, force est de constater que ce croisement est encore surtout l’apanage d’une historiographie anglo-saxonne, voire proprement américaine et que les études européennes privilégiant ce double prisme restent rares, du moins dans le champ historique, car elles se multiplient en sociologie, psychologie ou philosophie[4]. La revue Genesis a fait œuvre pionnière en proposant un dossier sur « Femmes et hommes dans l’histoire de l’environnement » en 2013[5], comprenant des travaux sur la place des femmes dans les combats environnementaux, sur les représentations genrées de territoires, sur l’expérience coloniale des épouses de colons, sur les femmes comme victimes particulières de dégâts environnementaux. Le présent appel à communication souhaite s’inscrire dans les voies ouvertes par ce numéro, tout en restreignant quelque peu le champ d’étude.
Nous souhaitons proposer en effet une réflexion sur les combats environnementaux en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, l’espace géographique ainsi défini incluant l’Europe occidentale, centrale et orientale, l’Europe du Nord et du Sud. Les deux derniers siècles ont en effet témoigné d’une redéfinition des rapports de genre, à l’occasion de revendications féministes et de bouleversements des structures traditionnelles par l’urbanisation et l’industrialisation, mais aussi d’une profonde mutation des relations entretenues avec l’environnement naturel, qui devient objet d’intérêt et de préservation.
Parmi les thématiques qui peuvent être abordées, sans exclusive :
– Le rôle des femmes, inconnues ou célèbres, dans les combats environnementaux ; quelle fut leur importance relative ? Ont-elles justifié leur action par des raisons de genre ? Le combat environnemental a-t-il pu être un moyen d’émancipation féminine? Quelle place pour les femmes aujourd’hui au sein des mouvements/partis écologistes européens, des associations de défense des animaux, mais aussi des projets de lutte alternatifs (mouvements altermondialistes, zones à défendre, espaces de résistance…) ?
– Des ménagères de l’environnement ? : La répartition des rôles au sein du foyer laisse, aujourd’hui encore, une lourde charge domestique aux femmes, qui, d’après des études sociologiques, sont plus sensibles et attentives à la protection de la nature, au recyclage, etc. Ce rapport particulier, genré et ancien, a-t-il incité des femmes à s’investir dans l’éducation à l’environnement, la salubrité des villes, la gestion des ressources naturelles ? A-t-il servi d’excuse pour les cantonner justement à certaines sphères d’intervention ?
– La convergence des luttes : est-il possible de mettre en évidence des combats communs entre groupes minorisés et lutte pour l’environnement ? Quelle place, par exemple, pour les lesbiennes dans l’engagement en faveur de la cause animale, dans les mouvements végétarien et vegan ? Dans quelle mesure les mouvements contre-culturels des années 1970 et 1980 (mouvements hippie, punk, squatters, alternatifs …), par exemple, ont-ils pu croiser lutte pour les droits civiques, féminisme, revendications LGBT, et problématiques environnementales ? Peut-on mettre en évidence les liens entre spécisme, ableism (« capacitisme »), sexisme et racisme ? Quelle place faire au genre dans les débats actuels sur la justice environnementale (Environmental Justice) et les inégalités écologiques en Europe ?
– Un écoféminisme avant la lettre ? : les femmes européennes ont-elles revendiqué, à l’instar de certaines de leurs consœurs américaines[6], une légitimité particulière dans la lutte environnementale, incriminant les hommes pour leur brutalisation de la nature ? Quelle place accorder en Europe à ce que Françoise d’Eaubonne nommera en 1974 « écoféminisme », qui fait le lien entre l’oppression des femmes et la dégradation de la nature ?
– Une lutte sentimentale ? : Les combats environnementaux sont-ils l’occasion de redéfinition des rapports de genre, ou de la place des femmes dans la société ? L’épithète « sentimental », associé tout aussi bien aux femmes qu’aux défenseurs de la nature, a souvent servi pour disqualifier l’action environnementale. Les femmes sont ainsi renvoyées à leur inaptitude première à agir dans la sphère publique, les hommes qui œuvrent avec elles perdant, quant à eux, toute virilité. Qu’en est-il de ces représentations stéréotypées à l’heure des ZAD et de l’écoterrorisme ?
– La nature a-t-elle un genre ? : Plus généralement, les rôles respectifs des unes et des autres dans les luttes environnementales reposent-ils sur une conception genrée de la nature ? Celle-ci est-elle le lieu d’une refondation de la virilité d’hommes abrutis par leur environnement urbain et industriel, ou d’une relation sensible et « féminisée » aux beautés du monde ? Dans quelle mesure la présence des femmes dans la recherche scientifique conduit-elle à remettre en cause les biais genrés des politiques industrielles et énergétiques ou de la recherche médicale par exemple, qui influent directement sur l’environnement ?
Les propositions, de 3000 signes maximum, en anglais ou en français, sont à envoyer accompagnées d’un CV à Charles-François Mathis (cfmathis@hotmail.com) et Florence Tamagne (ftamagne@gmail.com) avant le 15 janvier 2017. La sélection entre les propositions sera faite au plus tard le 15 février.
Les articles retenus, en anglais ou en français, devront être remis pour le 30 juin 2017. Ils seront soumis à expertise avant leur acceptation finale.
Cet AAA sera également disponible sur le site de la revue: https://genrehistoire.revues.org/
pdf : appel-n22
Call for papers for Genre & Histoire N° 22 (Fall 2018)
The nature of gender, the gender of nature: Environmental battles in Europe since the end of the 18th century
Although environmental history and gender history have both revitalized historical studies, they have for a long time followed different paths, that only crossed at the end of the 1980s, particularly in the work of Carolyn Merchant[1]. Two decades later, the assessment made by Nancy Unger is mitigated[2]: even though researches combining the two approaches have been more numerous, gender still remains quite marginal to the historiography of environmental history; when it is taken into consideration, the approach is often essentialist, the limits of which have been demonstrated by Melissa Leach and Cathy Green in a seminal article[3]. Moreover, this dual approach is mostly due to an Anglo-Saxon, or even American, historiography, whereas European studies remain relatively scarce, at least in history – they tend on the contrary to multiply in sociology, psychology or philosophy[4]. Genesis has been one of the first journals to publish a special issue in 2013 on “Women and men in environmental history”, dealing with the role of women in nature preservation, with a gender representation of the land, with the role of settler’s wives in colonial territories, and finally with women as victims of environmental catastrophes[5]. This call for papers wishes to follow the paths opened by this journal, while slightly narrowing its focus.
We would like to invite papers dealing with environmental battles in Europe since the end of the 18th century. The last two centuries have indeed witnessed a re-defining of gender roles and relations, due to feminist demands and to an upheaval of traditional structures triggered by industrialisation and urbanisation, but also a profound transformation in the way people relate to an environment that has become a matter of concern, and needs to be protected.
Some of the issues that could be dealt with are:
– Women’s roles: can we assess the role played by women, famous or unknown, in environmental battles? Have they justified their action by gender motives? Could environmental struggles be used as a tool for women’s emancipation? To what extent are women nowadays involved in European Green Parties, the environmental movement, animal rights organizations, but also alternative communities and activism (anti-globalisation movements, “Zones to Defend” (ZAD), etc.)?
– Environmental housewives? : the distribution of roles within the family shows that most women do assume a more important domestic workload than men, while some sociological studies demonstrate that they are more aware of landscape’s protection and recycling than most of the population. Has this specific, traditional gendered relation induced women to take part in environmental education, the cleanliness of towns and the managing of natural resources, or was it used as an excuse to limit women’s action to certain activities?
– Forging alliances: are minority groups especially involved in environmental struggles? What part, for example, have lesbians played in the fight for animal rights, or in the defense of vegetarianism and veganism? To what extent did the counter-culture of the 1970s and 1980s (hippies, punks, squatters…) take into account the demands for civil rights, feminism, LGBT rights, as well as the protection of the environment? Is it possible to establish a link between speciesism, ableism, sexism and racism? What are the gendered patterns of environmental inequalities in the current debate on environmental justice?
– Pioneers of ecofeminism? : have European women claimed, like some of their American sisters, that they have a particular legitimacy in the environmental struggle, making men responsible for the brutalization of nature? What role did ecofeminism play in Europe since 1974, when Françoise d’Eaubonne created this concept that links women’s oppression and the destruction of nature?
– A « sentimental » struggle? : do environmental struggles participate in the redefinition of gender and women’s roles? The epithet « sentimental » has been linked to both women and nature activists as a way to disqualify environmental struggles. Women have therefore been dismissed as unable to work in the public sphere, while men involved in feminist battles have been supposed to have lost all virile characteristics. What about these stereotypical representations in the time of ZAD and ecoterrorism?
– Does nature have a gender? : more generally, is the commitment of female and male environmental activists based on a gendered concept of nature ? Is nature the place where the virility of men, weakened by their urban and industrial environment, could be rebuilt, or does it offer the possibility of a sympathetic and “feminized” relation to the beauties of the world? To what extent could the presence of more women in scientific research negate the gender bias of industrial and energy policies or medical research, which have a direct impact on environmental policies?
Proposals for paper (CV + abstract no longer than 1000 words), in English or in French, should be submitted to Charles-François Mathis (cfmathis@hotmail.com) and Florence Tamagne (ftamagne@gmail.com) by 15 January 2017. Response to authors by 15 February 2017.
Selected papers, in English or in French, should be sent by 30 June 2017. They will be reviewed by experts before final acceptance.
pdf : appel-n22-anglais
[1] Carolyn Merchant : The death of nature : women, ecology and the scientific revolution, London, Wilson House, 1980 ; « Gender and Environmental History », The Journal of American History, vol. 76, 1990, p. 1117-1121.
[2] Nancy C. Unger, « Women and Gender. Useful Categories of Analysis in Environmental History », dans Andrew C. Isenberg, The Oxford Handbook of Environmental History, Oxford, OUP, 2014.
[3] Melissa Leach et Cathy Green, « Gender and Environmental History : from representations of women and nature to gender analysis of ecology and politics », Environment and History, vol. 3, n° 3, Octobre 1997, p. 343-370.
[4] See for instance: Anne-Lise Gandon, Les représentations sociales du développement durable : des enjeux de sexe et de genre, thèse de doctorat soutenue à l’Université Lyon 2, École doctorale Sciences de l’éducation, psychologie, information et communication, 2011 ; conference « Care, Genre et environnement », Université Lyon 3, from the 7th to the 11th of September 2015, organised by Hélène Guétat-Bernard, Pauline Texier-Teixeira, Pascale Moity Maïzi and Catherine Larrère ; Catherine Larrère, « L’écoféminisme : féminisme écologique ou écologie féministe », Tracés, n° 22, 2012/1 ; Jules Falquet, Sandra Laugier, Pascale Molinier, Genre et environnement. Nouvelles menaces, nouvelles analyses au Nord et au Sud, numéro des Cahiers du Genre, n° 59, 2015/2.
[5] Stefania Barca et Laura Guidi, Ecostorie. Donne et uomini nella storia dell’ambiante, numéro de Genesis, n° XII/2, 2013.
[1] Carolyn Merchant : The death of nature : women, ecology and the scientific revolution, London, Wilson House, 1980 ; « Gender and Environmental History », The Journal of American History, vol. 76, 1990, p. 1117-1121.
[2] Nancy C. Unger, « Women and Gender. Useful Categories of Analysis in Environmental History », dans Andrew C. Isenberg, The Oxford Handbook of Environmental History, Oxford, OUP, 2014.
[3] Melissa Leach et Cathy Green, « Gender and Environmental History : from representations of women and nature to gender analysis of ecology and politics », Environment and History, vol. 3, n° 3, Octobre 1997, p. 343-370.
[4] Voir par exemple : Anne-Lise Gandon, Les représentations sociales du développement durable : des enjeux de sexe et de genre, thèse de doctorat soutenue à l’Université Lyon 2, École doctorale Sciences de l’éducation, psychologie, information et communication, 2011 ; colloque « Care, Genre et environnement », Université Lyon 3, du 7 au 11 septembre 2015, organisé par Hélène Guétat-Bernard, Pauline Texier-Teixeira, Pascale Moity Maïzi et Catherine Larrère ; Catherine Larrère, « L’écoféminisme : féminisme écologique ou écologie féministe », Tracés, n° 22, 2012/1 ; Jules Falquet, Sandra Laugier, Pascale Molinier, Genre et environnement. Nouvelles menaces, nouvelles analyses au Nord et au Sud, numéro des Cahiers du Genre, n° 59, 2015/2.
[5] Stefania Barca et Laura Guidi, Ecostorie. Donne et uomini nella storia dell’ambiante, numéro de Genesis, n° XII/2, 2013.
[6] Voir les témoignages recueillis par exemple par Glenda Riley, Women and Nature: saving the Wild West, Lincoln, University of Nebraska Press, 1999.