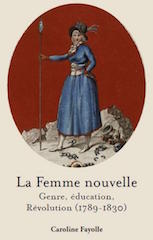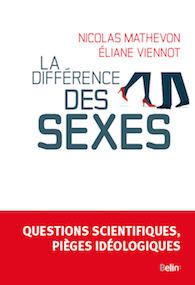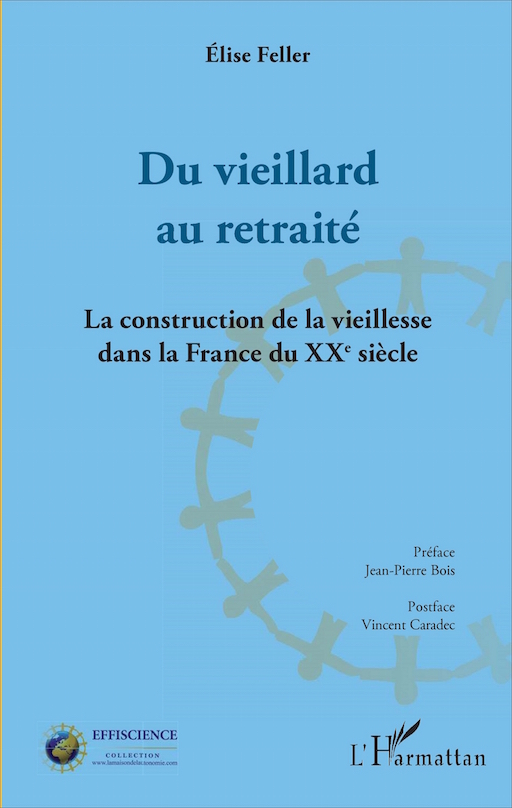Genre&histoire
18 | Automne 2016
https://genrehistoire.revues.org/.
Les directrices de publication Dominique Picco et Marianne Thivend
Articles
Camille Cordier
Le temps d’une vie bourgeoise : la construction des rôles genrés dans les livres de comptes de la famille Guérin-Borel au XIXe siècle [Texte intégral]
The different times of a bourgeois life: gender roles in the accounting books of the Guérin-Borel family in the nineteenth century
Caroline Muller
Un secret bien partagé. La place du directeur de conscience dans les négociations de mariage d’une famille noble (seconde partie du XIXe siècle) [Texte intégral]
Spiritual advising, secrecy and matrimony in a noble family (second half of the nineteenth century)
Anna Cabanel
Être, se représenter, se dire. Lettres d’étudiantes norvégiennes dans une nation en construction (fin XIXe – première moitié du XXe siècle) [Texte intégral]
To be, to portray oneself, to write about oneself : Letters from Norwegian female students in the nation-building process (from the end of the 19th century to the first half of the 20th century) [mention spéciale du jury du prix Mnémosyne 2014 pour son mémoire « Pionnières du Nord – Universitaires norvégiennes et réseaux féminins internationaux (1882-1940) », sous la direction d’Olivier Wievorka, ENS de Cachan, et de Sylvie Chaperon, Université de Toulouse Jean Jaurès, 2014.]
Jérôme Pelletier
Pour une histoire de l’enseignement agricole féminin durant les années 1950-60 : les écoles ménagères agricoles du Loir-et-Cher ou l’éducation contrariée au rôle de femme d’exploitant [Texte intégral]
Female agricultural training in the 1950s and 1960s: Agricultural home economic schools for girls in the Loir-et-Cher; challenging the gendered lessons of future female farm workers in the 1950s and 1960s
Sara Panata
Les militantes yorubas se mettent en scène : la politisation du corps habillé à l’époque coloniale [Texte intégral]
Yoruba women activists strike a pose: the politicisation of clothed bodies during the colonial era
Itinéraire
Jean-Baptiste Bonnard
Entretien avec Claude Mossé [Texte intégral]
Travaux soutenus
Azzurra Tafuro, “Madri di molte patrie”. Usages et représentations de la figure maternelle dans les cultures politique du XIXe siècle (Italie-France, 1850-1870) [Texte intégral]Thèse d’histoire, ENS(Pise)-EPHE, sous la codirection de Daniele Menozzi et Gilles Pécout, soutenue le 23 avril 2015
Nataliya Borys, La tractoriste et la fashionista. Deux représentations des femmes dans le magazine soviétique ukrainien Radianska zhinka (Femme Soviétique) dans les années 1960-1980 [Texte intégral] Master d’histoire, soutenu le 10 novembre 2015, sous la direction de Delphine Gardey, Université de Genève
Comptes rendus
Anita Guerreau-Jalabert
G. Alfani, V. Gourdon, I. Robin (dir.), Le parrainage en Europe et en Amérique. Pratiques de longue durée (XVIe-XXIe siècle) [Texte intégral] Bruxelles, Peter Lang, 2015, 487 p.
Nicole Fouché
Sylvie Aprile, Maryla Laurent, Janine Ponty, avec une préparation documentaire de Elżbieta Łątka et Monika Salmon-Siama, Polonaises aux champs. Lettres de femmes immigrées dans les campagnes françaises, 1930-1935 [Texte intégral] Paris, Numilog, 2015, 282 p.
Isabelle Matamoros
Caroline Fayolle et Laurent Colantonio (coord.), Genre et utopie. Avec Michèle Riot-Sarcey [Texte intégral] Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2014, 403 p.
Stéphane Le Bras
Jean-Louis Escudier, Les Femmes et la vigne : une histoire économique et sociale, 1850-2010 [Texte intégral] Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2016, 375 p.
Christine Machiels
Lola Gonzalez-Quijano, Capitale de l’amour. Filles et lieux de plaisir à Paris au XIXe siècle [Texte intégral] Paris, Vendémiaire, 2015, 256 p.
Nicolas Patin
Elissa Mailänder, Female SS Guards and workaday violence. The Majdanek Concentration Camp, 1942-1944, translated by Patricia Szobar [Texte intégral]
Michigan State University Press, East Lansing, 2015 [2009], 434 p.
Amélie Nuq
Marissal Claudine, Protéger le jeune enfant. Enjeux sociaux, politiques et sexués (Belgique, 1890-1940) [Texte intégral]
Bruxelles, éditions de l’université de Bruxelles, 2014, 380 p.
Nataliya Borys
Marian Rubchak, New imaginaries: youthful reinvention of Ukraine’s cultural paradigm [Texte intégral] New York: Berghahn Books 2015, 330 p.
Irène Gimenez
T. Terret, L. Robène, P. Charroin, S. Héas, P. Liotard (dir.), Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle [Texte intégral]
Presses universitaires de Rennes, 2013, 784 p.