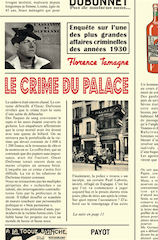Julie Le Gac et Fabrice Virgili présentent le recueil en 3 minutes
L’Europe des femmes XVIIIe-XXIe, Paris, Perrin, 2017
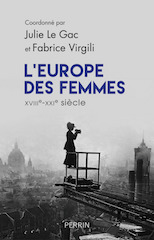
Ouvrage collectif pensé et réalisé par : Peggy Bette, Sonia Bledniak,
Myriam Boussahba-Bravard, Anne-Laure Briatte, Véronique Garrigues, Louis-Pascal Jacquemond, Julie Le Gac, Amandine Malivin, Dominique Picco, Yannick Ripa, Mélanie Traversier et Fabrice Virgili.
Partenariat Mnémosyne – LabEx EHNE
Vidéo : L’Europe des femmes en 3 minutes
et en anglais : L’ Europe des Femmes, 2017, an anthology for Europeans and the World
Revue de presse et du web
Ouest France 24 mai 2019
« L’Europe, une chance pour les femmes ? Le genre de l’intégration européenne », codirigé par Anne-Laure Briatte, Éliane Gubin et Françoise Thébaud, est issu d’un colloque organisé par le laboratoire EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l’Europe). Ce laboratoire de recherche a produit également une encyclopédie en ligne (https ://ehne.fr/) et l’ouvrage L’Europe des femmes, XVIIIe-XXIe siècle, recueil de textes écrits par des femmes de toute l’Europe, coordonné par Julie le Gac et Fabrice Virgili.
50/50 Magazine, 23 mai 2019
« Cet ouvrage inédit montre à quel point les femmes d‘Europe ont contribué à son développement, à son rayonnement scientifique et à sa vie intellectuelle et artistique, tout en luttant pour être reconnues dans leur domaine d‘excellence. Chaque chapitre est accompagné d‘une bibliographie précise qui permet de mieux connaitre la personne présentée et son époque, il peut donc constituer un point de départ pour des études approfondies de l‘une ou l‘autre de ces formidables Européennes »
Var Matin, Nice Matin, Monaco Matin, 21 janvier 2018
« ça vient de paraître, entretien avec Julie Le Gac et Fabrice Virgili. (…) « A propos du harcèlement sexuel, nous présentons dans le recueil un texte d’Adelheid Popp, une Autrichienne qui en 1909 décrit comment les ouvrières sont des « proies » pour leur contremaîtres et employeurs L’actualité montre a quel point plus de cent ans après, son combat demeure d’actualité »
Vingtième siècle Revue d’histoire, janvier-mars 2018
« Juchée sur une structure métallique, une silhouette féminine en robe, redingote et chapeau, photographie la ville de Berlin en 1910. La couverture de L’Europe des femmes est sans ambiguïté : les femmes portent un regard sur le monde auquel elles participent et qu’il est nécessaire de redécouvrir. »
Clara, janvier-février 2018
Une histoire européenne des femmes. Ce livre est une première. On y trouve les textes, dans leur langue d’origine et traduits en français, de femmes aussi connues qu’Alexandra Kollontal ou Virginia Woolf mais aussi de femmes moins connues, ou d’hommes «féministes». (…) Avec une première grande partie, « On ne naît pas femme on le devient », qui annonce le parti pris résolument féministe de la douzaine d’auteur e s qui a participe a cet ouvrage. Une œuvre importante qui, au travers d’une disparité voulue des documents (chansons, discours, correspondance, texte littéraires, affiches), forme un panorama assez précis de l’histoire des femmes européennes
Féminitude, décembre 2017
« Ces femmes qui en trois siècles nous ont faites européennes et libres. Donner la parole en version originale aux Européennes aux penseuses et actrices de trois siècles d’histoire, telle est la mission que remplit avec pertinence l’essai L’Europe des femmes. Un livre passionnant qui met en perspective les préoccupations égalitaristes et libératrices des femmes. Un opus a mettre entre toutes les mains »
Libération, 27 décembre 2017
« L’histoire de Woolf à Lobkovskaya. Aussi riche par ses sources que par leur variété. [Ce recueil] réunit 77 textes de femmes et d’hommes, célèbres ou beaucoup moins : Virginia Woolf, Anne Frank, Nicolas de Condorcet ou Fifi Brindacier, mais aussi les «trois Marias», qui publièrent un magnifique texte féministe sous la dictature portugaise, la pacifiste autrichienne Bertha von Suttner ou Nina Lobkovskaya, tireuse d’élite dans l’armée de Staline – interdite d’entrée à Berlin et priée de se faire discrète une fois la guerre gagnée. Un panorama européen complété par des affiches et photos, comme celle des mannequins d’accouchement de Mme du Coudray, qui permirent, au XVIIIe siècle, de former des sages-femmes dans tout le royaume et de baisser le taux de mortalité en couches. »
Libération – Next, 23 décembre 2017
« L’essentiel, cependant, tient à ce que les documents recueillis — fictions, chansons, affiches, discours, essais, correspondances, objets, photographies — disent de «la diversité des expériences du peuple des femmes», qu’elles soient artistes, intellectuelles, ou migrantes, ouvrières, domesti- ques, paysannes. »
Causette, décembre 2017
« Si l’on retrouve nos chères Simone Weil ou Virginia Woolf, on découvre également une palanquée de femmes inconnues et incroyables, telle l’Espagnole Josefa Amar y Borbon et son «Plaidoyer pour l’intelligence des femmes», qui date de 1786. S’ajoute à cela une riche iconographie. La garantie d’une balade réussie à travers l’Histoire Où se confirme que le développement du féminisme (le mouvement préexiste au mot), depuis trois siècles, a été une lutte de tous les pays. »
Fabula.org, 1er décembre 2017.
nonfiction.fr, 30 novembre 2017.
« Très attendu dans le domaine des « gender studies », L’Europe des femmes (XVIIIe-XXIe siècle), sous la direction de Julie Le Gac et Fabrice Virgili est assurément novateur par son angle d’approche et sa volonté de diffuser les derniers résultats de la recherche historique dans le domaine de l’histoire des femmes. Longtemps resté en retrait, malgré les travaux pionniers de Michèle Perrot, celle-ci connaît, en France, un nouveau souffle depuis quelques années ; ce livre en est la preuve. » (…) Un livre majeur sur l’histoire des femmes L’Europe des femmes est un livre militant, soutenu par l’association Mnemosyne (qui défend le développement d’une histoire des genres). Les auteurs l’annoncent dès l’introduction : « Ce livre a vocation à sensibiliser les jeunes générations, et les moins jeunes, aux inégalités du genre ». Il ne s’agit pas ici d’un livre épistémologique réservé aux spécialistes qui a pour but de définir et de faire évoluer les « gender studies ». Comme son illustre prédécesseur l’Histoire des femmes en Occident, dirigé par Georges Duby et Michèle Perrot, l’Europe des femmes est là pour montrer comment vivent les femmes en Europe depuis le XVIIIe siècle. Certes, ce dernier est moins ambitieux que l’histoire totale voulue par l’Histoire des femmes en Occident qui a embrassé toute l’histoire depuis l’Antiquité. L’entreprise se place néanmoins dans la lignée de ce que voulaient faire Duby et Perrot, c’est-à-dire présenter les dernières avancées de la recherche à un large public. L’Europe des femmes n’assomme pas son lecteur de notions, ni d’articles très longs. Un livre à la fois accessible, militant et européen
Les clionautes : la cliothèque
« C’est donc un livre d’une grande richesse que L’Europe des femmes. Il trouvera bien sa place dans les CDI et cabinets d’histoire des établissements scolaires. Certes, il ne couvre qu’une (large !) période contemporaine, et ne répond toujours pas entièrement aux besoins des enseignants du secondaire, en mal de réaliser une histoire mixte avec les documents qui leurs sont proposés par les manuels scolaires, mais il offre d’intéressantes perspectives dans le domaine historique, et l’on ne peut qu’être séduit.e par l’ambition européenne de l’ouvrage. »
Les Affiches de Normandie, 29 novembre 2017.
« S’il est un ouvrage original, riche, mais attendu, c’est bien L’Europe des femmes. XVIIIe-XXIe siècle, (…) il parcourt trois siècles tumultueux, des Lumières à l’avancée spectaculaire de ce qu’on a appelé «la révolution féministe», où l’on s’est interrogé sur les rapports de genres, la place de la femme dans l’intime et dans la cité. »
L’Agefi – indices (Suisse)13 novembre 2017, Notre part d’humanité. « Un ouvrage unique qui permet de prendre conscience du chemin emprunté par la moitié de l’humanité pour sortir du statut de minorité d’aucuns ont voulu et veulent encore la maintenir. »
CNRS Le Journal, n°290, automne 2017, « Histoire de femmes », p.62.
Blog littéraire, L’amour des mots, léger badinage, 9 octobre 2017 :
« J’ai énormément apprécié cette lecture car au delà de l’évident sujet du féminisme qui me passionne, j’ai pu découvrir des auteurs et des textes qui m’étaient inconnus. Je vous le recommande, homme et femme du XXIème siècle qui souhaitent apprendre d’hier pour créer demain ! »
criminocorpus, septembre 2017 : « Pour la première fois rassemblés et commentés plus de 70 textes fondateurs de l’histoire des femmes, du XVIIIE siècle à nos jours »
 Le 9 juin prochain, vous êtes invités à vous rendre dans les services partenaires de l’opération afin d’y présenter vos souvenirs familiaux.
Le 9 juin prochain, vous êtes invités à vous rendre dans les services partenaires de l’opération afin d’y présenter vos souvenirs familiaux.

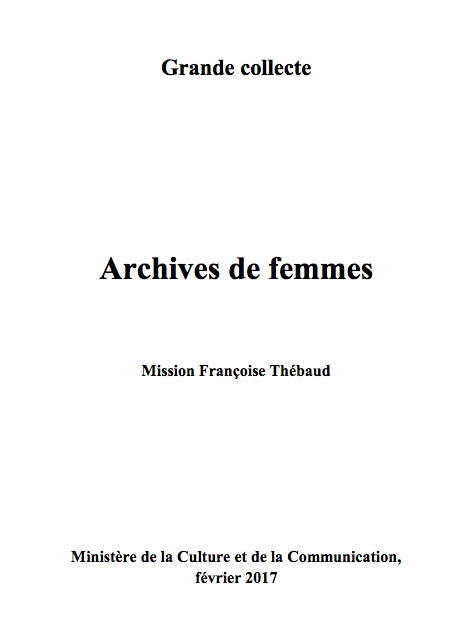
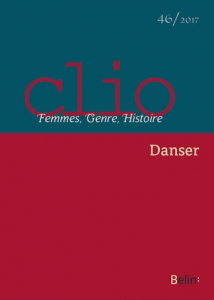

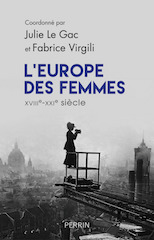

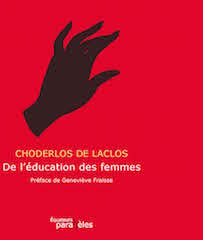
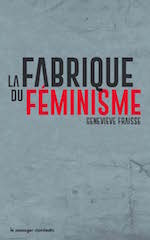 Geneviève Fraisse, Le passager clandestin, 2018
Geneviève Fraisse, Le passager clandestin, 2018