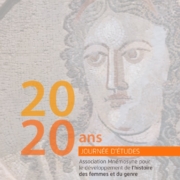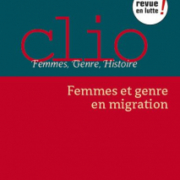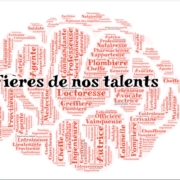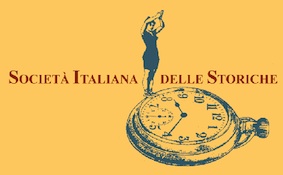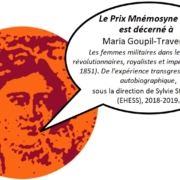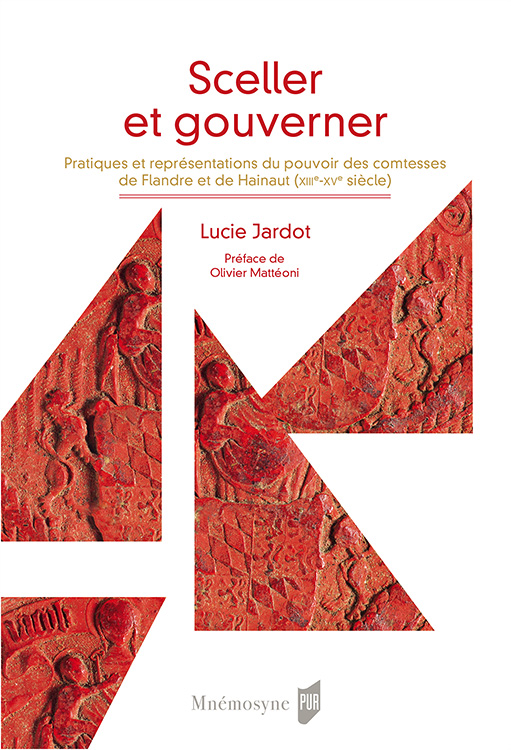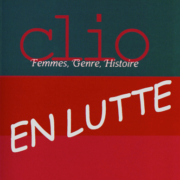Clio. Femmes, Genre, Histoire
n° 51 (printemps 2020)
Femmes et genre en migration
Responsables du numéro :
Linda GUERRY & Françoise THÉBAUD
S’inscrivant dans une actualité politique et scientifique, ce numéro de Clio, attentif aux approches et sources nouvelles, questionne les femmes et le genre en migration au cours de l’histoire. De l’Antiquité à la période très contemporaine, les contributions, qui s’intéressent à des migrations de grande ampleur, proposent de nouvelles lectures des mouvements migratoires, montrent la capacité d’agir des femmes migrantes mais aussi les contraintes liées aux rapports de genre. Ce dossier interroge également ce que fait la migration à la féminité, à la masculinité, aux rôles socio-sexués, en mobilisant la notion de réagencement de genre.
« Revues en lutte »
Sciences en danger, revues en lutte. Par le collectif des revues en lutte, le Comité de rédaction de Clio. FGH & Camille Noûs
Editorial
Linda GUERRY & Françoise THÉBAUD
Éditorial. Femmes et genre en migration
Dossier
Marie-Adeline LE GUENNEC
Mobilités et migrations féminines dans l’Antiquité romaine. Une histoire fragmentaire
Irene BARBIERA
Du fer et du sang. Le genre des Grandes invasions (IVe-VIe siècle)
Virginie ADANE
Des Provinces-Unies à la vallée de l’Hudson. Réagencement de genre en Nouvelle-Néerlande (1624-1664)
Elisa CAMISCIOLI
La « traite des femmes », une histoire de migrations (France-Cuba, début du XXe siècle)
Stéphanie CONDON
Entre stratégies individuelles et stratégies de l’État. Le genre de l’émigration antillaise dans les années 1960
Regards complémentaires
Chiara QUAGLIARIELLO
Donner ou non la vie à Lampedusa. Histoires de migrations plurielles
Joachim HÄBERLEN
« En route vers la liberté » ? Trois récits de réfugiées musulmanes en Allemagne
Isabelle LACOUE-LABARTHE & Alice LACOUE-LABARTHE
La trilogie Istanbul-Berlin d’Emine Sevgi Özdamar. Genre et écriture entre deux mondes
Actualité de la recherche
Nancy GREEN
Quatre âges des études migratoires
Documents
Elise VALLIER-MATHIEU
La migration noire américaine. Le récit de vie de Jane Edna Hunter (1882-1971)
Linda GUERRY
Réunir les familles séparées par la migration. Récits de l’Immigrants’ Protective League à Chicago, 1931
Andrew DJ SHIELD
Turcs et Marocains aux Pays-Bas pendant la Révolution sexuelle (1964-1979). Une analyse photographique
Témoignage
Marianne AMAR
Migrantes au musée. Questions posées à l’histoire (entretien) par Linda GUERRY & Françoise THÉBAUD
Portrait
Anna BELLAVITIS
Angela Groppi (1947-2020), pionnière de l’histoire des femmes en Italie
Varia
Isabelle MATAMOROS
L’habitude de bien lire. Lectures quotidiennes d’une jeune bourgeoise dans les années 1820
Solange LAPEYRIÈRE
Celles qui sortent et celles qui restent. « Carrières asilaires » des femmes internées dans les asiles en France au XIXe siècle