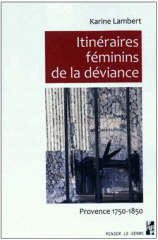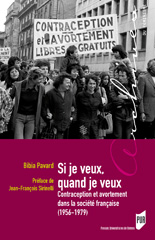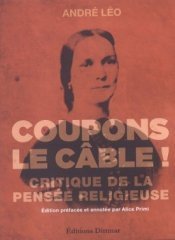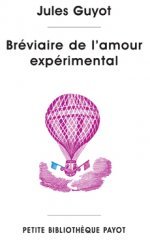Trois initiatives :
à la Machine à lire , rencontre avec Françoise Thébaud autour du livre
publié sous l’égide de l’association Mnémosyne et qu’elle a co-dirigé :
La place des femmes dans l’histoire (éditions Belin).


co-organisée avec l’atelier Genre de l’université Bordeaux III et l’association Mnémosyme. Elle sera animée par Anne-Marie Cocula.
« Que transmettons-nous aujourd’hui à nos enfants ? Certes, une histoire riche et complexe. Mais son récit – au masculin ou au neutre pluriel – reste partiel et partial, en décalage avec la mixité de nos sociétés démocratiques et l’état de la recherche scientifique. En respectant les programmes scolaires actuels et les passages obligés de la culture historique des citoyennes et citoyens de demain, cet ouvrage tente de proposer un autre récit qui sorte les femmes de l’ombre. Ni geste héroïque au féminin, ni histoire victimaire, il présente le nuancier infini des relations entre hommes et femmes, rend compte de leurs actions respectives et s’interroge sur le sens que chaque société attribue au masculin et au féminin.
Chapitres de substitution et chapitres de complément forment la trame d’un livre d’histoire mixte et offrent un ensemble de dossiers documentaires adaptés à une exploitation pédagogique.
Destiné aux professeurs de l’enseignement secondaire et élémentaire, aux étudiants, aux parents d’élèves, il s’adresse également à tous les lecteurs et lectrices conscients que les femmes, comme les hommes, font l’histoire. »
Françoise Thébaud est professeure émérite d’histoire contemporaine à l’université d’Avignon et codirectrice de la revue Clio. Histoire, femmes et sociétés. Ses nombreuses publications d’histoire des femmes et du genre portent sur la guerre, la maternité, les féminismes, l’historiographie.
La Machine à lire – 8, place du Parlement – 33000 Bordeaux – France
tél : 33 (0)5 56 48 03 87 – fax : 33 (0)5 56 48 16 83
Le Séminaire du Centre d’Etude des Mondes Modernes et Contemporains,
Réseaux de femmes, femmes en réseaux : approches méthodologiques
Organisé par D.Dussert-Galinat et D.Picco Pessac,
Université Bordeaux3, 7 mars 2012, 14h30-17h30, MSHA salle 2
avec
– Pascal Cristofoli (EHESS) : Partir des femmes et des relations pour étudier une société villageoise. Une première partie de l’exposé rappellera les principes méthodologiques de l’analyse des données relationnelles et des réseaux sociaux, en insistant notamment sur les changements de focale d’observation qu’elle autorise. Nous présenterons ensuite quelques résultats d’une recherche en cours sur l’histoire démographique, politique et sociale du Val de Bagnes qui s’intéresse explicitement au rôle des femmes dans une telle société . Cela nous permettra d’interroger de manière réflexive la place des femmes à chacune des étapes de la recherche (sources, méthodologies et analyses) et d’envisager les apports spécifiques de cet angle d’observation pour l’étude de la parenté et de la sociabilité villageoise, économique et politique…
– Cyril Grange (CNRS) : Les réseaux d’alliances de la bourgeoisie juive parisienne au XIXe siècle : une analyse à partir du logiciel Puck (Program for the Use and Computation of Kinship data) Le logiciel Puck (Program for the Use and Computation of Kinship data) résulte d’une rencontre entre ethnologues et historiens autour d’un projet commun : l’analyse systématique des relations de consanguinité et de mariage à partir de nouveaux outils conceptuels et techniques. L’exposé sera consacré à une présentation des principales fonctionnalités de Puck ainsi qu’à certaines conclusions tirées à partir de l’observation d’un réseau composé des familles de la haute bourgeoisie juive financière et industrielle installée à Paris à la fin du XIXe. On a pu notamment relever l’émergence de figures utérines à partir de 1880 qui ne doit cependant pas être lue comme l’introduction d’une nouvelle forme d’alliance en tant que telle mais plutôt comme le résultat de l’effacement des unions agnatiques, largement dominantes auparavant.
– Françoise Thébaud (université d’Avignon), Histoire des femmes et du genre et analyse des réseaux : questionnements, méthodes, apports Après avoir rappelé ce qu’est le projet historiographique de l’histoire des femmes et du genre, je m’interrogerai sur la place (faible et récente) des questionnements en termes de réseaux, sur les méthodes empiriques que le champ de recherche met en œuvre pour les appréhender et les sources qu’il mobilise, sur les apports de ces recherches. Je développerai particulièrement la question des réseaux militants (notamment féministes) et l’intérêt des correspondances militantes.
Journée de la femme « Féminin plurielles »
Tables rondes (programme en fichier pdf) organisées par le Conseil général de la Gironde
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Conseil général de la Gironde invite toutes les femmes à une journée d’échanges, de débats sur de nombreuses questions relatives à la place de la femme dans la société, les résistances tenaces……..