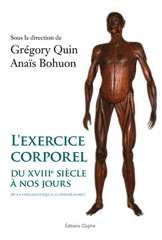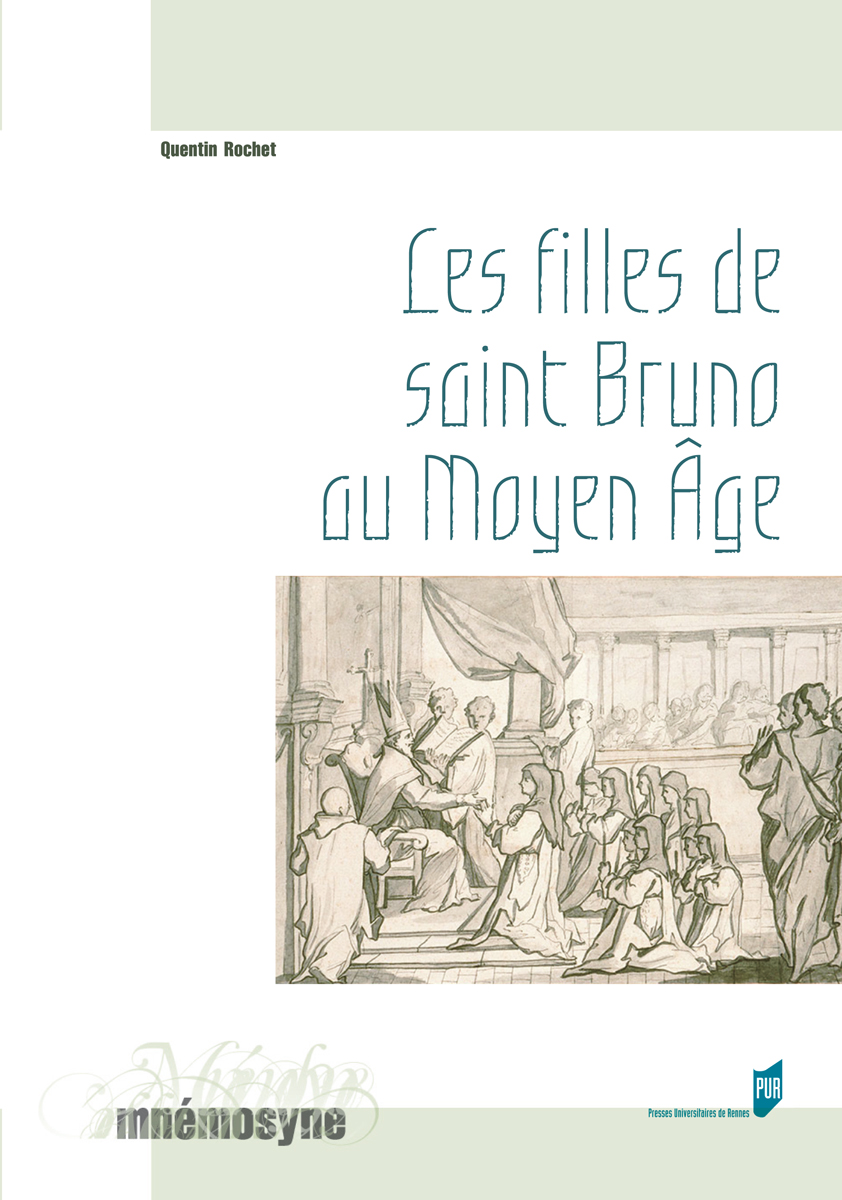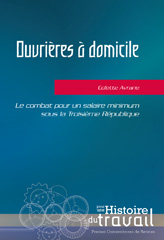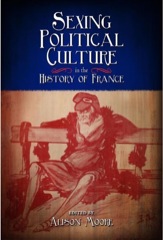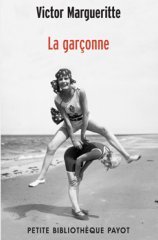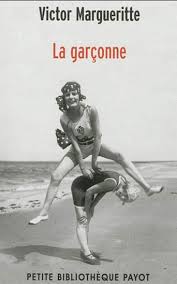À l’image des mouvements qui les ont produites, les affiches féministes sont hétéroclites, foisonnantes, utopiques. Et contrairement aux affiches communistes, socialistes ou fascistes, elles n’ont pas été fabriquées par des partis ou des organisations centralisées et structurées, mais par des groupes pluriels. Leur production laisse davantage place à l’artisanat. Leur objectif est de rendre visibles les femmes, les oppressions qu’elles subissent ou leurs combats. Il s’agit aussi de convaincre de la légitimité de la revendication de l’égalité entre les sexes, et d’influencer les mentalités en changeant les images disponibles, en revalorisant la femme et en proposant des rôles sexués alternatifs. Les affiches féministes sont ainsi en dialogue avec celles des partis politiques, mais également avec celles de la culture de masse, en particulier la publicité. Et comme il n’y a pas un féminisme, mais une multitude, cela conduit à une grande variété de styles et de messages. Pour autant, il est possible de repérer des continuités dans les thèmes abordés. Les auteures en ont retenu six : la vie politique ; le travail ; la maternité et la famille ; la colonisation et l’immigration ; la création artistique ; l’institutionnalisation du féminisme. Au-delà des évolutions chronologiques, ces questions traversent, comme autant de fils rouges, les luttes des femmes du XXe et du XXIe siècle.
http://www.myboox.fr/livre/femmes-en-lutte-2233365.html
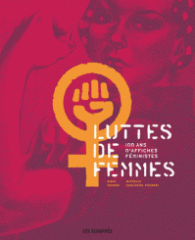 Bibia Pavard & Michelle Zancarini-Fournel,
Bibia Pavard & Michelle Zancarini-Fournel,
Éditions Les Échappés, 2013.