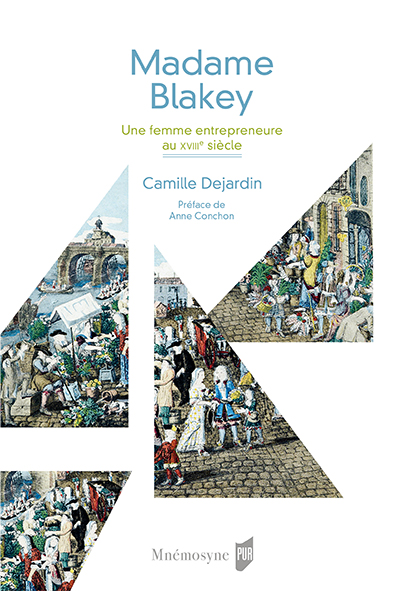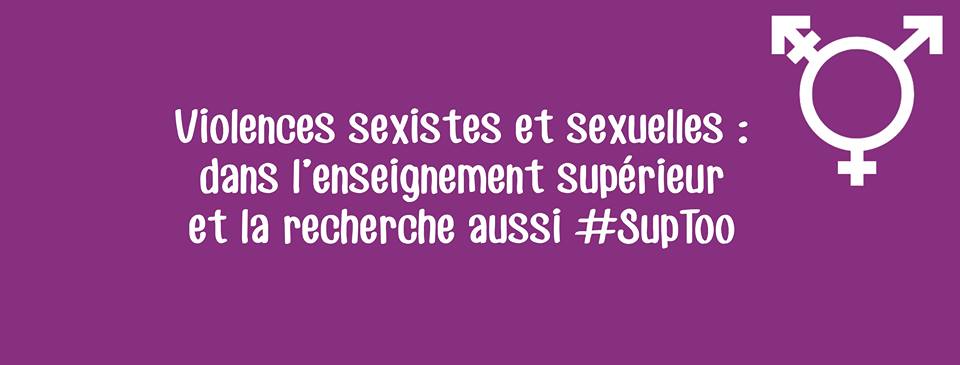Suite à notre réponse aux nouveaux programmes, une interview de Cécile Beghin, vice-présidente de Mnémosyne paru dans le quotidien Le Monde, supplément Idées daté du 15 décembre 2018 :
Les femmes ne font-elles jamais l’histoire ?
Le Conseil supérieur des programmes renvoie les femmes aux oubliettes de l’histoire, déplore Cécile Beghin, historienne et membre du bureau de l’association Mnémosyne.
L’association Mnémosyne, qui œuvre au développement de l’histoire des femmes et du genre et dont vous êtes vice-présidente, observe un « recul de trente ans » dans les nouveaux programmes d’histoire au lycée. Pour quelles raisons ?
En dépit de notre demande, Mnémosyne n’a pas été consultée par le Conseil supérieur des programmes [CSP], ni aucune autre association travaillant sur l’égalité hommes-femmes. Nous n’avons observé, de la part du CSP, aucune volonté de nous faire participer à leur élaboration. Les programmes de lycée qui nous sont proposés marquent un retour au « roman national », centré sur la construction de la France et ses grandes évolutions politiques, c’est-à-dire une histoire stéréotypée, datée, et essentiellement masculine. Les femmes n’y occupent aucune place, à l’exception de quelques personnages « prétextes »…
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/14/les-femmes-ne-font-elles-jamais-l-histoire_5397304_3232.html
La réponse de Mnémosyne aux nouveaux programmes mise en ligne le 26 novembre dernier
L’association Mnémosyne pour le développement de l’histoire des femmes et du genre souhaite répondre publiquement à la consultation sur les nouveaux programmes d’histoire proposés par le ministère de l’éducation nationale et le CSP présidé par Mme Souad Ayada. Après une lecture attentive du préambule et des différents thèmes proposés dans les programmes de seconde et de première, l’association souhaite rappeler certains points.
Depuis plus de vingt ans, des problématiques de recherche nouvelles en histoire des femmes et du genre se sont développées en France comme dans le reste du monde. Il s’agit pour de nombreux chercheurs et chercheuses de toutes nationalités qui souhaitent considérer les femmes comme des actrices à part entière de l’histoire, et dénoncer les mécanismes de domination et d’invisibilisation que les femmes subissent dans la plupart des disciplines des sciences sociales, d’appliquer au champ historique des questionnements nouveaux, d’interroger différemment les sources, d’ouvrir plus largement les champs de recherche balayés par les études historiques. Le travail de ces chercheurs et chercheuses a progressivement pris sa place au sein des universités, et l’histoire des femmes et du genre, à travers des enseignements ou dans les orientations de recherche proposées aux étudiants, rencontre un succès croissant. D’un côté des mémoires de master 1 ou 2, des thèses de doctorat s’inscrivent de plus en plus souvent dans ces problématiques et Mnémosyne récompense tous les ans d’un prix un mémoire de master d’histoire ayant adopté une problématique de genre. De l’autre, les concours de recrutement d’enseignants pour l’histoire-géographie (capes et agrégation) proposent de plus en plus de sujets d’écrits et d’oraux relatifs à la question des femmes et du genre.
Ce mouvement scientifique accompagne une évolution globale de la société qui aspire à une plus grande égalité entre les sexes, et si la discipline historique doit « aider à cerner l’évolution de la société », elle doit également y participer. Faire de l’histoire aujourd’hui, ce n’est plus étudier quelles furent les « actions et les décisions de leurs acteurs », c’est observer quels furent les rôles et les décisions de leurs acteurs et de leurs actrices. Et si les femmes n’ont pas toujours pu « être actrices » ou « prendre des décisions », il semble nécessaire d’en expliquer les raisons pour construire une société plus juste et plus égalitaire. S’il est important pour la recherche française de participer à une évolution épistémologique qui touche l’ensemble de la planète, il est indispensable de proposer à nos enfants une éducation qui leur permette de penser l’égalité des sexes, de comprendre qu’il ne s’agit pas là d’une évidence, d’un invariant historique, mais au contraire d’un combat dont ils sont eux-mêmes actrices et acteurs.
Dans le cadre de l’éducation nationale et des cours d’histoire, il est nécessaire que les programmes indiquent aux enseignants la route à suivre pour transmettre une histoire mixte. « Comprendre le monde actuel », « l’appréhender de façon distancée et réfléchie », devenir un citoyen éclairé dans un espace civique qui aspire à plus de tolérance et d’égalité, ce n’est pas seulement se familiariser à l’histoire politique et militaire de la France ; c’est avoir accès à des champs de recherche contemporains, à des questionnements renouvelés qui permettent à nos élèves, garçons et filles, de se reconnaître et de se projeter dans notre corps social mixte. L’enjeu est de taille.
Dans l’association Mnémosyne, nous travaillons en ce sens auprès des enseignants, des collégiens et des lycéens depuis des années et nous avons à plusieurs reprises participé à des rencontres avec les concepteurs de programme pour leurs communiquer nos recommandations. Associée à d’autres représentants soucieux de l’Égalité femmes-Hommes, notre association avait demandé à être entendue par le CSP en juillet 2018. Mais cette demande de Mnémosyne n’a reçu aucune réponse et les nouveaux programmes soumis à consultation nous font reculer de trente ans dans l’enseignement de l’histoire. Les femmes n’y occupent aucune place, à l’exception de quelques rares figures historiques égarées dans les « points de passages et d’ouverture ». Le choix de mettre à l’honneur une histoire politique et militaire dans les programmes de première, et d’accorder si peu de place à l’histoire sociale ou culturelle, renvoie les femmes aux oubliettes de l’histoire. Il s’agit d’une régression, qui ne correspond en aucun cas aux aspirations de la société actuelle, et a fortiori à celles de la jeunesse qui doit s’y « reconnaître ». Si éduquer, c’est « dépasser les évidences », il nous semble nécessaire de dépasser l’évidence d’une histoire de facto masculine par omission du féminin, qui ne permet à aucun jeune lycéen et à aucune jeune lycéenne, de se sentir concerné-e.
Réponse Mnémosyne Programmes Lycée


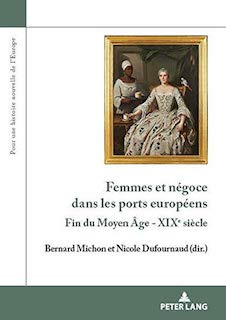

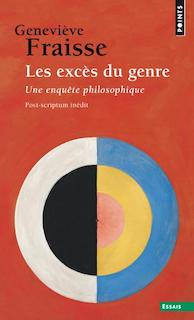 Geneviève Fraisse,
Geneviève Fraisse,