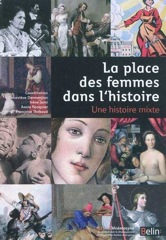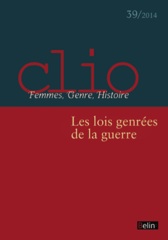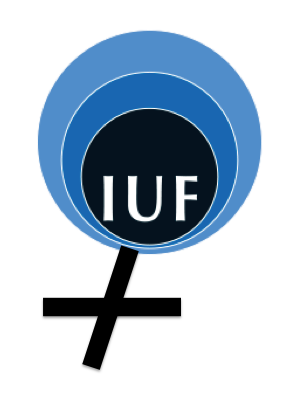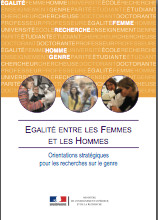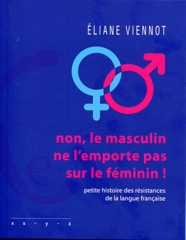Mnémosyne est co-signataire du courrier adressé par l’Association de recherche sur le genre en éducation et formation (ARGEF) aux ministres des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et à la Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.
« La loi de refondation de l’école et de rénovation de la formation des enseignant.e.s et des personnels d’éducation précise que tou.te.s les étudiant.e.s ont droit à une formation aux questions relevant des thématiques interrogées par les études de genre.
A cette occasion, notre association de recherche, ARGEF-France, veut promouvoir 30 années de recherche sur ces thématiques et soutenir des propositions concrètes d’enseignement sur le genre.
L’enjeu est considérable, si nous voulons, comme le demande la loi, que tou.te.s les enseignant.e.s, éducatrices et éducateurs soient formé.e.s. Ces enseignements leur donneront les moyens de répondre aux parents et aux partenaires sur des questions qui parfois ne font pas consensus mais répondent aux inégalités scolaires, sociales, culturelles et s’inscrivent dans les missions de l’école.
Aussi nous attirons votre attention sur les urgences suivantes :
Identifier la réalité des enseignements sur le genre, dans les maquettes de master et leur mise en œuvre
Promouvoir des propositions concrètes pour ces enseignements obligatoires
Assurer la mise en œuvre de ces enseignements dans chaque ÉSPÉ pour chaque mention de master MEEF
Dans une perspective de mise en synergie des différents partenaires et afin de favoriser un aboutissement indispensable, nous sollicitons l’organisation d’une rencontre rassemblant les différents partenaires et interlocuteurs concernés : Représentant.e du Ministère du Droit des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, du Ministère de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Secrétariat d’État de l’enseignement supérieur et à la recherche, du Département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations, de la direction des ÉSPÉ, des Universités, des Rectrices et Recteurs d’Académie, du Conseil supérieur des programmes
des Associations de recherche et d’enseignant.e.s.