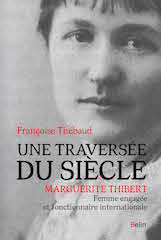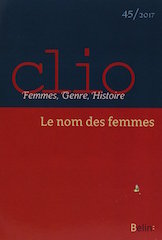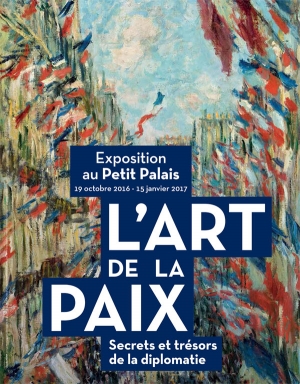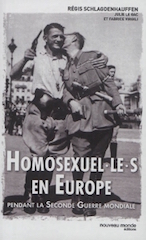Genre & Histoire 19 | Printemps 2017
Genre et engagement en temps de guerre (XVIe-XXIe siècles)
Sous la direction de Marie Derrien, Fanny Giraudier et Charlotte Gobin
- Marie Derrien, Fanny Giraudier et Charlotte Gobin, Introduction – Penser l’engagement en temps de guerre au prisme du genre (XVI-XXIe siècles)
- Jasmina Cornut, Implications féminines dans l’entrepreneuriat militaire familial en Suisse romande (XVIIe-XVIIIe siècles)
- Solenn Mabo, Femmes engagées dans la chouannerie : motivations, modalités d’actions et processus de reconnaissance (1794-1830)
- Alexandre Dupont, Soignantes et consolatrices ? Femmes contre-révolutionnaires dans la Seconde guerre carliste (Espagne, 1872-1876)
- Guillaume Pollack, Genre et engagement dans la Résistance : l’exemple d’Anne-Marie Walters
- Marie Janot-Caminade, Les « Malgré-Nous » et les « Malgré-Elles » : l’influence d’une catégorisation genrée sur la visibilité des témoignages des incorporé.e.s de force alsacien.ne.s dans la sphère publique pendant la Seconde Guerre mondiale
- Stéphanie Monay, Femmes militaires dans un contexte d’armée de milice « sans conflit » : quelles logiques d’engagement ?
Itinéraires
- Didier Lett et Christiane Klapisch-Zuber, Entretien avec Christiane Klapisch-Zuber
Varia
- Emmanuelle Palermiti, Jeux de voiles, expression du deuil féminin et valeur de l’enveloppement dans la quête de la déesse Déméter
- Liviana Gazzetta,La collaborazione femminile al sacerdozio nelle istituzioni ecclesiali di primo Novecento: il caso delle Figlie del Cuore di Gesù davanti al Sant’Uffizio [La dévotion à la « Vierge Prêtre », une voie mariale à la prêtrise féminine ? Le Saint-Office face aux Filles du Cœur de Jésus au début du XXe siècle]
- Victoria Afanasyeva, Pratiques de mobilisation des femmes pour la cause antialcoolique en France : militantes, enseignantes, femmes de plume (1873-1903)
Travaux soutenus
Masters candidats aux prix Mnémosyne
Résumés des thèses - Pauline Boivineau, Danse contemporaine, genre et féminisme en France (1968-2015), Thèse de doctorat en histoire, université d’Angers, sous la direction de Christine Bard, soutenue le 18 décembre 2015
- Brice Chamouleau, Genre et classe : poétiques gay dans l’espace public de l’Espagne post-franquiste (1970-1988), Thèse de doctorat en études hispaniques, Université Bordeaux-Montaigne, École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques de la Casa de Velázquez, sous la direction de François Godicheau, soutenue le 24 novembre 2014. [à paraître sous le titre : Tiran al maricón. Los fantasmas queer de la democracia (1970-1988), Madrid, Akal, 2017]
- Magali Guaresi, Parler au féminin : les professions de foi des député-e-s sous la Cinquième République (1958-2007), Thèse de doctorat en histoire, niversité de Nice Sophia Antipolis, sous la direction de Damon Mayaffre et Jean-Paul Pellegrinetti, soutenue le 14 décembre 2015
- Tzu-Hsuan Sung, Cosmétiques, beauté et genre en Chine. Une analyse de la presse et des publicités (Fin des Qing – 1930), Thèse de doctorat en histoire, ENS de Lyon, sous la direction de Christian Henriot, soutenue le 20 novembre 2015
Résumés HDR
- Sophie Coussemacker, La chevauchée des femmes. Pratiques et symboliques de la monte féminine au Moyen Âge, Mémoire inédit du dossier d’habilitation à diriger des recherches (garant : Martin Aurell), Université de Poitiers, 2016
- Patrick Farges, “À hauteur d’homme”. Pour une histoire située de la migration forcée après 1933 , Dossier d’habilitation à diriger des recherches (garant : Bernard Banoun), Université Paris-Sorbonne, 2016
Comptes rendus
- par Nathalie Sage Pranchère : Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, Emmanuelle Berthiaud, Le Rose et le Bleu. La fabrique du féminin et du masculin, Paris, Belin, 2016, 380 p.
- par Nataliya Borys : Delphine Gardey, Le Linge du Palais-Bourbon. Corps, matérialité et genre du politique à l’ère démocratique, Lormont, Le Bord de l’eau, 2015, 259 p.
- par Gérard Delille : Laura Graziani Secchieri (dir.), Vicino al focolare e oltre ; spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia (secc. XV-XX), Florence, Giuntina, 2015, 413 p.
- par Patrick Farges : Agnès Martial (dir.), Des pères « en solitaire » ? Ruptures conjugales et paternité contemporaine, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2016, 201 p.
- par Antony Favier : Régis Revenin, Une histoire des garçons et des filles. Amour, genre et sexualité dans la France d’après-guerre, Paris, Vendémiaire, 2015, 352 p.
- par Agnès Walch : Irène Théry, Mariage et filiation pour tous. Une métamorphose inachevée, Paris, Seuil, 2016, 123 p.
- par Lola Gonzalez-Quijano : Clive Thomson, Georges Hérelle, Archéologie de l’inversion sexuelle « fin de siècle », Paris, Éditions du Félin, 2014, 414 p.
- par Sarah Kiani : Carola Togni, Le genre du chômage. Assurance chômage et division sexuée du travail en Suisse (1924-1982), Lausanne, Éditions Antipodes, 2015, 371 p.
***
La revue Genre & Histoire, revue électronique créée en 2007 à l’initiative de l’association Mnémosyne, (www.mnemosyne.asso.fr), est un espace de publication ouvert à toutes celles et ceux dont les recherches s’inscrivent dans le domaine du genre avec une attention plus particulière aux étudiant-e-s (Master et Doctorat) d’histoire ainsi qu’à celles et ceux d’autres disciplines – sociologie, philosophie, anthropologie, géographie, sciences politiques, sciences de l’éducation, littérature, civilisations, Staps – dont les travaux comportent une dimension historique. Outre des articles scientifiques, elle accueille, pour le moment, différentes rubriques : résumés de travaux soutenus, bibliographies thématiques, itinéraires.
Directrices de publication : Dominique Picco, Marianne Thivend
Comité de rédaction : Karen Adler, Jean-Baptiste Bonnard, Claire Chatelain, Patrick Farges, Christopher Fletcher, Alain Hugon, Irène Jami, Ulrike Krampl, Amélie Nuq, Dominique Picco, Valérie Pouzol, François Rouquet, Marianne Thivend, Violaine Tisseau, Mélanie Traversier